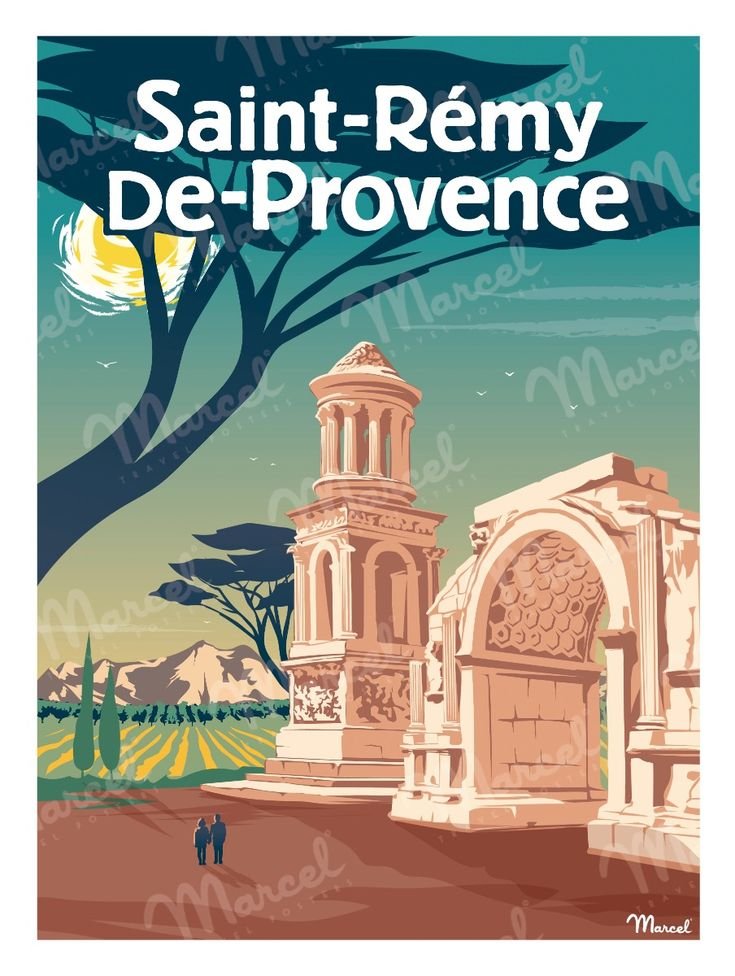Le petit radar qui n’était pas comme les autres et le jeune homme à l’air lunatique.
Le petit radar qui n’était pas comme les autres et le jeune homme à l’air lunatique.
Il était une fois, au pied des Alpilles, sur les bords de la départementale qui relie la nationale 7 au village de Saint-Rémy de Provence, non loin des iris de Van Gogh, de la terre ocre et des champs de lavande tels que les a peints Paul Guigou, et des paysans de Jean-François Millet qui s’arrêtent au milieu des moissons pour prier à l’heure de l’Angélus, un petit radar qui n’était pas comme les autres. Défaut de fabrication ou génération spontanée, il n’avait d’automatique que le nom et son intelligence n’était pas aussi artificielle qu’on aurait pu le souhaiter. Il ne pouvait s’empêcher de penser et c’est peut-être là une des causes des ennuis qu’il devait rencontrer par la suite.
Il regrettait de n’avoir pas de voix ; s’il en avait eu une, il aurait aimé avoir celle, tour à tour chaude et caressante comme le soleil d’Occitanie, tonitruante et enjouée, parfois sentencieuse, de Fernandel dans le rôle de Don Camillo ou lors de son périple à travers la Provence en compagnie de son cheval dans le film d’Henri Colpi Heureux qui comme Ulysse (1970), ou encore celle, rocailleuse, caverneuse, truculente et sensible du griot provençal Jean-Pierre Chabrol racontant, à la manière du Giono des Âmes fortes, les histoires parfois inspirées de légendes aux parents et amis réunis autour du feu de bois pour entendre la saga de leur propre vie quotidienne, histoires réunies dans son livre Les Mille et une veillées et plus tard enregistrées sur un disque. Il n’aurait pas détesté avoir celle de Roberto Alagna pour pouvoir chanter avec l’autorité d’un ténor les airs du Bel Canto italien, et en particulier le Lucevan le stelle de Puccini avec son final :
E lucevan le stelle,
ed olezzava la terra
stridea l'uscio dell'orto
ed un passo sfiorava la rena.
Entrava ella fragrante,
mi cadea fra le braccia.
O dolci baci, o languide carezze,
mentr'io fremente le belle forme disciogliea dai veli !
Svanì per sempre il sogno mio d'amore.
L'ora è fuggita, e muoio disperato !
E non ho amato mai tanto la vita !
… ou celle de Cecilia Bartoli ou de Nathalie Dessay pour entonner les airs de musique sacrée tels qu’on peut les entendre sur l’album Sacrificium, la scuola dei castrati, ces hommes dont la virilité avait été sacrifiée pour qu’ils aient des voix semblables à celles du cristal. C’était un radar qui avait des goûts très variés et un peu d’ambiguïté dans le genre n’était pas pour lui déplaire. Pour le dire clairement, il n’aurait rien eu contre un peu de féminisation mais, conscient d’être doté d’un physique qui ne se prêtait pas à toutes les lubies et que tout ne lui allait pas avec un égal bonheur, il préférait s’en tenir sagement aux atours d’une sobriété qui confinait à l’austérité, ce qui ne le privait toutefois pas d’admirer ceux qui savaient mettre de la fantaisie dans leur mise pour être les artistes d’eux-mêmes et apporter ainsi un peu de gaieté, de joie et de réconfort à leurs contemporains. Ces opinions avancées, pour ne pas dire hétérodoxes, le faisaient mal voir des autres radars, qui se contentaient de servir le pouvoir et voyaient en lui un prétentieux ; en conséquence, ils ne se fréquentaient pas – eux, c’était eux et lui, c’était lui –, et tandis que les autres attendaient sagement des promotions pour services rendus qui ne viendraient jamais, lui bouillait intérieurement, quoique d’une énergie brouillonne, sur son bord de départementale.
Était-il malheureux ? Regrettait-il de ne pas voyager ? Des voyages, il en avait faits, ne serait-ce que celui qui l’avait conduit du centre technique où il avait été conçu à l’emplacement qui lui était destiné. Ses principaux voyages avaient cependant été intérieurs, nourris par le rêve et l’imagination. La proximité de Saint-Rémy de Provence lui avait permis d’être croisé par beaucoup de touristes, certains célèbres et fortunés, qui venaient se reposer au village à la belle saison. Il avait ainsi des lettres et se piquait même parfois de philosophie. Mais comment cela était-il possible ? Comment expliquer ce phénomène étrange ? Ces touristes, célèbres ou non, qui venaient parfois de pays étrangers fort lointains, lui parlaient-ils de littérature, de ces écrivains étrangers qui enrichissent notre connaissance de l’expérience humaine, et de leur contrée d’origine ? Nul ne le sait, mais toujours est-il que le petit radar qui n’était pas comme les autres s’enrichissait intellectuellement à leur contact.
Un jour, le radar qui n’était pas comme les autres fut croisé par un jeune homme qui lui fit l’effet d’être un pierrot lunaire, un naufragé de la modernité qui ne savait pas très bien où il allait, malheureux en amour, pas très heureux au jeu et dont les ambitions intellectuelles étaient limitées par sa frivolité, bien qu’il eût essayé d’être un étudiant appliqué. Il s’en allait rendre visite à son grand-oncle, un homme qu’il admirait beaucoup parce qu’il n’avait pas peu contribué à le déniaiser sur beaucoup de sujets, comme l’argent, le sexe, les relations affectives et même le maniement des armes à feu. C’était une belle après-midi d’automne, et les couleurs des arbres flamboyaient dans cette lumière de Provence qui avait rendu fou Van Gogh et bien d’autres peintres, il portait sa belle veste en laine d’étudiant en sciences politiques qui avait fait dire à sa grand-mère paternelle qu’il jouait au « petit Monsieur » ; cette même grand-mère à qui il avait envoyé une carte postale lors de son séjour à Palerme, quand il faisait du tourisme en novembre 2007 et qu’il avait vu l’endroit où la voiture du juge Falcone avait été pulvérisée par la bombe que les hommes de main de la mafia avaient placée sous la route en mai 1992 ; si à cette époque, il avait eu une culture littéraire, et pas seulement cinématographique, il aurait su que la Sicile, c’était aussi l’île qui avait vu naître Leonardo Sciascia et Luigi Pirandello, soit l’écrivain qui avait dénoncé le phénomène mafieux à une époque, les années 1960, où personne ne voulait y croire, dans des romans qui avaient été adaptés au cinéma, et le dramaturge, prix Nobel de littérature en 1934, qui avait renouvelé le théâtre en centrant son œuvre sur le thème de la folie, malgré sa proximité avec le régime fasciste, dans des pièces comme Six personnages en quête d’auteur, Henri IV, À chacun sa vérité, ou La Fuite, une pièce que le jeune homme à l’air lunatique devait découvrir au festival d’Avignon un peu plus tard et dans laquelle le grand dramaturge sicilien interrogeait notre difficulté à accepter nos propres erreurs, dans un questionnement sur les arrangements de chacun avec sa propre conscience ; la solution du personnage principal était simple : comme il a de la difficulté à accepter ses propres erreurs, il en fait porter la responsabilité sur les autres. Pour en revenir à la grand-mère du jeune homme à l’air lunatique, elle ne devait jamais recevoir la carte postale et c’est lui qui la récupérerait à son retour, de la même manière que son autre grand-mère, sa grand-mère maternelle, celle qui lui avait légué en même temps que son amour de l’Italie, ses conférences sur l’art, Goya, le Grand Canal à Venise, l’art gothique à Venise, l’art baroque à Rome, Palladio, Michel-Ange, Le Tintoret, Canaletto, devait se faire incinérer le jour de son anniversaire, le 29 octobre 2012 (1). Et lui se souvenait d’être allé à Venise, peut-être pour oublier ses peines de cœur, sur les pas de Proust en tout cas, qui avait écrit des choses étonnantes sur l’amour et la jalousie : non pas l’amour qui engendre la jalousie, mais la jalousie constitutive de l’amour, sur la permanence de la beauté entre l’art byzantin et l’art chrétien, sur la beauté qui est une promesse de bonheur, tandis que la philosophe Simone Weil affirmait que si le monde n’est pas Dieu, il en garde la trace, qui est la beauté ; et lui, le jeune homme était allé à Venise, peut-être pour vérifier ces théories, bien qu’il connût la phrase de Pessoa sur l’instinct sacré de n’avoir pas de théorie, et celle d’Enrique Vila-Matas qui affirmait que pour bien écrire, il fallait abandonner les théories littéraires, les abandonner toutes, visiter des pays, les abandonner, et puis écrire ce qu’on avait envie. Il était allé à Venise pour voir la beauté et puis il était revenu, comme plus tard il irait à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et il reviendrait, mais il n’écrivait pas exactement ce qu’il voulait, comme si la volonté lui faisait défaut, à l’image de ces écrivains romantiques malades de ne pas savoir vouloir, comme Proust. Comme Proust, le jeune homme connaissait Schopenhauer et savait que la volonté est une ruse du vouloir-vivre, cette force obscure qui travaille les hommes à l’égal de leurs pulsions et de leurs désirs. Et comme Proust, qui avait traduit La Bible d’Amiens de John Ruskin, le jeune homme traduirait plus tard, à l’âge mûr, des textes de ses écrivains favoris, Leopardi, Tchekhov, Dino Buzzati, Cesare Pavese, pour améliorer sa connaissance des langues russe et italienne, et parce qu’il les trouvait beaux. Mais en attendant, il avait visité Venise, il s’était promené sur la place Saint-Marc, ainsi que dans le musée Correr, entre les œuvres de Canova, de Giovanni Bellini, de Vittore Carpaccio, d’Antonello da Messina, il avait admiré le style néo-classique du palais royal abritant les « procuraties », nom donné à Venise aux bâtiments de l’administration, et le campanile, reconstruit à l’identique après s’être effondré en 1902, le style byzantin de la basilique, la tour de l’Horloge avec son cadran si important pour ce peuple de marins, surmonté du lion ailé, symbole de la cité, et des deux jacquemarts qui sonnent les heures, tellement sombres qu’on les surnomme les Maures, il était passé entre les colonnes rostrales pour aller observer le soleil couchant derrière San Giorgio Maggiore depuis la riva degli Schiavoni avant d’aller écouter un concert dans l’église de la Pietà, celle d’Antonio Vivaldi, le « prêtre roux ». Il avait pris un bellini au Danieli, un carpaccio au Harry’s Bar, un verre de Soave sur le petit marché sous le pont du Rialto, il s’était perdu avec délice entre les « sestieri » de Canareggio et de Castello, au milieu des « campi (2)» et des « pozzi », à la recherche de l’atelier du Titien, ainsi que dans le quartier de l’Arsenal à la nuit tombée, il s’était arrêté sur les Fondamente Nuove pour scruter l’île du cimetière San Michele, dans lequel reposaient notamment Stravinsky (3) et Diaghilev, l’impresario des ballets russes, il avait marché sur la « Fondamenta delle Zattere » depuis la Douane de mer, dans le Dorsoduro, face au canal de la Giudecca, en rêvant à la bataille de Lépante, à laquelle avait pris part Cervantès en 1571, ou à la silhouette d’Ezra Pound, qui l’avait pourtant fait souffrir avec ses hermétiques Cantos, dont il avait déniché un exemplaire dans une petite librairie du campo « Zanipolo (4)», à l’ombre de la basilique et de la statue équestre du Colleoni, un des « condottieri (5) » de la Renaissance, avant d’aller assister à la représentation de La Force du Destin de Verdi au théâtre de la Fenice (6). Et puis il était revenu.
Il s’était arrêté près du radar, et celui-ci avait compris qu’il avait du mal avec les femmes mais pas seulement. Le radar eut pitié de lui et lui demanda d’où il venait. D’abord surpris, le jeune homme à l’air lunatique ne mit pas longtemps à accepter l’idée qu’un radar puisse parler ; il se souvenait d’Oscar Wilde qui affirmait qu’il pouvait croire à tout pourvu que ce soit incroyable. Il répondit ainsi au radar qu’il revenait d’un séjour en Angleterre, le premier en solitaire depuis les séjours linguistiques de son adolescence, et qu’il allait rendre visite à son grand-oncle. Il ne put s’empêcher de confier au radar combien il avait été émerveillé par la richesse des monuments de la capitale anglaise, la Tour de Londres où étaient enfermés les ennemis des rois d’Angleterre, le Globe Theatre, reconstruit exactement comme il était du temps de Shakespeare avec son toit en chaume, le Strand avec le Savoy où avaient séjourné Oscar Wilde et le peintre Monet quand il inventait le style impressionniste en peignant la Tamise, Westminster, Big Ben et le pont de Waterloo dans une lumière tamisée par la brume, Covent Garden où Hitchcock avait tourné des scènes de son avant-dernier film, Frenzy (1972), les quartiers chics de Belgravia, Chelsea, Knightsbridge, Oxford Street où flottait encore un parfum des « Swinging Sixties », Baker Street où il n’y a pas de 221B (7), Bloomsbury, à côté du British Museum, qui a donné son nom au groupe formé autour de Virginia Woolf et dont David Garnett, l’inoubliable auteur de La femme changée en renard (Lady into Fox, 1922) faisait partie, et à côté de Hyde Park, où il s’était promené et avait découvert la Serpentine et Speaker’s Corner, Mayfair, où se trouvaient la célèbre rue des couturiers fabriquant des costumes sur mesure, Savile Row, mais surtout les ambassades qui avaient nourri l’imagination des auteurs de romans d’espionnage comme John le Carré.
Je me souviens que celui-ci déclarait que les idéalistes se trouvent à l’est, une phrase qui peut sembler étrange (8), mais avec laquelle seront d’accord tous ceux qui ne se satisfont pas du consumérisme occidental, à commencer par Dominique Fernandez qui m’a donné envie d’aller en Russie, mais aussi ceux qui font le pèlerinage en Israël à la recherche des lieux saints. John le Carré avait également été impliqué dans une polémique avec Salman Rushdie sur le problème de la religion. Lui affirmait qu’ « aucune loi de la vie ou de la nature ne dit que les grandes religions peuvent être insultées impunément » et que « le principe absolu de la liberté de parole n’existe dans aucune société », et l’auteur des Versets sataniques lui répondit qu’ « Un examen de la noble formulation de le Carré révèle que :
1. Il adopte la ligne islamiste philistine, réductioniste et radicale selon laquelle Les Versets sataniques n’étaient rien d’autre qu’une insulte.
2. Il suggère que quiconque déplaît à ces islamistes philistins, réductionistes et radicaux perd le droit de vivre en paix (…) »
À l’époque, le jeune homme à l’air lunatique n’était pas très au fait de ces polémiques, il nourrissait cependant déjà une profonde aversion pour la religion, nourrie par son admiration pour Salman Rushdie, dont il avait lu Le dernier soupir du Maure, publié en 1995, mais aussi pour la laïcité à la française, héritière des Lumières, ainsi que pour le marquis de Sade et son pamphlet Français, encore un effort si vous voulez être républicains (9). Il considérait que toutes les religions sont des facteurs de guerre, chaque monothéisme tendant à la domination universelle malgré les conciles œcuméniques qui n’ont que peu d’impact sur la vie quotidienne des peuples. Pour avoir lu Marx, il savait aussi que la religion, bien avant le sport, était un opium du peuple. À la lumière de ce qui est arrivé à Samuel Paty, décapité par un islamiste radical pour avoir exercé son métier d’enseignant consistant à expliquer pourquoi des humoristes avaient éprouvé le besoin de caricaturer Mahomet, cette conviction pourrait être renforcée si elle ne devait être nuancée par la formulation de le Carré qui affirme qu’aucune loi de la vie ou de la nature ne permet d’insulter impunément les grandes religions. Il serait par exemple hâtif d’affirmer que la religion est la principale source de la morale, nécessaire aux gouvernants pour faire régner l’ordre social. Cela résulterait d’une lecture superficielle de Machiavel.
— Il serait déjà plus juste de dire que la religion inculque des valeurs morales aux hommes, objecta le petit radar.
— Certes, mais la laïcité aussi peut jouer le même rôle, quand elle est défendue par des penseurs comme Albert Camus (10), répondit le jeune homme.
Ce qu’ils ne savaient pas tous les deux, c’est que le philosophe Henri Bergson avait essayé de dépasser l’opposition entre religion et laïcité dans son ouvrage de 1932 Les deux sources de la morale et de la religion, dont le dernier chapitre contient le passage assez fameux sur le « supplément d’âme » dont le corps serait en attente, à la suite des possibilités extraordinaires que lui confère la technique, réflexion placée sous le signe d’une autre dualité, la mystique/le mécanique :
« Ne nous bornons pas à dire, comme nous le faisions plus haut, que la mystique appelle le mécanique. Ajoutons que le corps agrandi attend un supplément d’âme, et que la mécanique exigerait une mystique. Les origines de cette mécanique sont peut-être plus mystiques qu’on ne le croirait ; elle ne retrouvera sa direction vraie, elle ne rendra des services proportionnés à sa puissance, que si l’humanité qu’elle a courbée vers la terre arrive par elle à se redresser, et à regarder le ciel. »
Ch. IV. Remarques finales. Mécanique et mystique. PUF.
À leur décharge, précisons que le petit radar et le jeune homme avaient des références moins pointues et plus accessibles : « Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d’entre nous regardent les étoiles » (Oscar Wilde) ; le petit radar avait quelques notions concernant les mises en garde d’Heidegger contre la volonté de puissance qui s’actualise à travers la technologie, tandis que le jeune homme en tenait pour Les Temps modernes, réalisé en 1936 par Charlie Chaplin, une subtile satire de l’aliénation par le travail à la chaîne ; il aimait d’ailleurs les films emblématiques de cette époque, À nous la liberté de René Clair (1931), La Belle Équipe de Julien Duvivier (1936), Toni (1935) et La Règle du jeu (1939) de Jean Renoir, tout d’abord en raison de leur esthétique en noir et blanc, et puis aussi parce que c’étaient des films qui parlaient de révolte, d’insoumission à l’autorité, de refus de la norme et surtout de pas de côté. Sans oublier les films noirs américains de la même époque et dont James Cagney était l’acteur principal, dans un registre plus violent, conformément à l’idiosyncrasie (11) américaine… mais on ne peut pas tout voir non plus.
Ils se quittèrent bons amis, d’abord sur une blague… Toujours difficile et périlleux à expliquer, les blagues, mais je vais quand même essayer de vous expliquer celle qui fit rire nos deux compères : en faisant une sorte d’ « expression-valise » de deux titres de Boris Vian, Et on tuera tous les affreux, et J’irai cracher sur vos tombes, le jeune homme promit au petit radar qu’il irait cracher au visage de tous les affreux qui leur pourrissaient la vie, comme par exemple le boucher du village, qui non seulement maltraitait les animaux, mais mettait au supplice les jeunes gens trop timides et effacés en abusant de leur patience pour faire sa diva devant les bigotes de province… C’était surtout pour rire et divertir le petit radar qui lui paraissait bien isolé ; c’est qu’il était vraiment jeune et innocent, en ce temps-là, le jeune homme à l’air lunatique, il ne se rendait pas compte… Le nombre d’affreux… Pourtant, il était déjà passé par l’école, les écoles, les grandes et les petites… Il aurait dû savoir. On est toujours jugé ; sans cesse, il faut se justifier, défendre son style en même temps que son identité, son amour-propre et ses idées… sa manière de voir. Et ça n’était pas fini, il croyait en être sorti, mais ça n’était qu’une illusion. Plus sérieusement, ils se promirent d’évoquer les lieux où souffle l’esprit : le jeune homme avait déjà évoqué la colline de Sion, à l’est de Charmes, non loin de laquelle il lisait Les Déracinés de Maurice Barrès à l’ombre d’un mirabellier, à la saison des vendanges, tout en observant le ballet des ouvrières agricoles penchées dans les vignes, lequel ressemblait à celui des mondines (12) des rizières de la plaine du Pô, dans le Piémont, entre Novare et Vercelli, suscitant ses premiers émois d’adolescent. Cette vision enchanta le petit radar, qui n’en attendait pas plus.
Ce jeune homme, le radar devait le revoir par la suite, quand il rendrait visite à sa grande-tante (13) au retour de quelque périple en Italie pour lui raconter sa découverte des villes d’art, avant d’aller en Arles pour apprendre à bien voir une corrida, à la manière d’Hemingway, et en Camargue, à Maillane ou à Tarascon, parce que ces lieux lui évoquaient certains de ses écrivains préférés, Joseph d’Arbaud, Frédéric Mistral et Alphonse Daudet (14). Bien que peu loquace et toujours pressé, le jeune homme lui laissa un jour une édition de poche d’un écrivain italien. C’est ainsi que le petit radar se familiarisa avec la littérature engagée en général et italienne en particulier, ce qui lui permit de fortifier sa conscience sociale. Il commença par L’Affreux pastis de la rue des merles (Quer brutto pasticcio di via Merulana) de l’ingénieur Gadda, Alberto Moravia, qui dans ses romans, Le Conformiste, L’Ennui, La Désobéissance, avait impitoyablement disséqué les contradictions et la psychologie de la bourgeoisie romaine, tandis que dans ses nouvelles, Les Nouvelles romaines par exemple, il décrivait la vie des petites gens des faubourgs comme devait le faire plus tard Pasolini dans ses films, Accatone ou Mamma Roma… Ce jeune homme admirait aussi beaucoup le cinéma, celui contemplatif et baroque, de Fellini à Sorrentino, de La Dolce Vita (1960) à La Grande Bellezza (2013), des méditations métaphysiques empreintes d’une ironie parfois féroce, parfois tendre envers les monstres contemporains, désemparés face à la beauté qui les entoure, en passant par les Vitelloni (1953), dont les personnages déambulaient sur la plage de Rimini en attendant que l’un d’entre eux n’aille tenter sa chance à Rome, mais aussi le cinéma politique de Nanni Moretti, lorsque celui-ci n’avait pas hésité à s’en prendre à Berlusconi (15), alors au faîte de sa puissance, faisant passer ses intérêts personnels avant le service de l’État et de ses concitoyens les plus démunis, quand lui avait surtout fait du tourisme dans la Ville Éternelle… qui lui laissait un regret, n’être pas allé dans le cimetière protestant, non loin de la pyramide de Cestius, pour se recueillir sur les tombes d’Antonio Gramsci et de John Keats, comme l’avait fait Oscar Wilde.
Mais le radar se piquait également de philosophie et de métaphysique : c’est ainsi qu’il connaissait Nietzsche et Schopenhauer qu’il opposait volontiers aux arrière-mondes (16) et à la morale abstraite de Kant, même s’il devait reconnaître que ce dernier était le précurseur d’Emmanuel Lévinas et de son éthique de la responsabilité pour autrui.
Alors, dans son activité, le radar qui n’était pas comme les autres ne pouvait s’empêcher d’introduire un peu de subversion. Certes, il était un peu voyeur mais quel radar ne l’était pas ? Il prenait en photo les voitures qui dépassaient les limitations de vitesse comme il avait été programmé pour le faire et ignorait les autres. Il avait cependant une faiblesse, il admirait les belles étrangères et plus particulièrement les belles carrosseries uniques conçues à la grande époque, celle d’avant l’uniformisation et le nivellement par la technologie : les Aston Martin, les Ferrari, les Maserati et les Lamborghini ; il avait bien entendu parler des Trabant et des Lada, et ces noms exotiques lui inspiraient une tendresse mêlée d’affection, mais il devait reconnaître qu’il n’en voyait pas beaucoup du côté de Saint-Rémy de Provence. Elles n’auraient sans doute pas eu la puissance nécessaire pour dépasser les limitations de vitesse, mais si elles l’avaient fait, le radar sentait bien qu’il aurait fait ce qu’il faisait pour les belles étrangères, à la carrosserie unique dessinée par les « designers » les plus prestigieux de chez Pininfarina, il aurait flouté leur plaque d’immatriculation. C’était cela son vice : fasciné par la vitesse, et plus encore par ceux qui osent transgresser les règles en se moquant bien de l’ordre et de la morale, il ne pouvait s’empêcher de faire une exception pour eux et de flouter leur plaque d’immatriculation. Ce comportement discriminant n’était non seulement pas très malin, mais il était aussi parfaitement scandaleux : non seulement il ne volait pas les riches pour donner aux pauvres, comme étaient censés le faire les bandits de grand chemin magnifiés par la fiction – et, précisément pour cette raison, un esprit lucide aurait pu à tout le moins faire preuve de scepticisme à l’égard de cette réputation de générosité au grand cœur de ces héros populaires, de Robin des Bois à John Dillinger en passant par Gaspard de Besse et Jesse James – mais il volait la grande majorité des contribuables soumis et besogneux au profit de quelques m’as-tu-vu désinvoltes et blasés. À ce comportement étrange, il y avait une première explication : le radar qui n’était pas comme les autres n’était pas très malin. Il y avait cependant d’autres raisons qui pouvaient expliquer cette bizarrerie : fasciné par la vitesse et ceux qui transgressent les règles, le radar qui n’était pas très malin l’était tout autant par tout ce qui brille et dont l’authenticité n’est pas garantie. Le petit radar était en fait très snob. Ce rapport désinvolte à l’argent était nourri par une aversion pour les solides vertus bourgeoises que sont le travail et l’économie. Le radar éprouvait également un mépris avéré pour les masses de travailleurs besogneux et honnêtes qui ne se révoltaient pas contre un pouvoir politique qui les manipulait avec des gratifications symboliques, du pain et des jeux, tout autant que pour le zèle que les autres radars déployaient dans l’accomplissement de leur mission de service public. Depuis qu’il se piquait de philosophie, qu’il avait appris l’existence des ouvrages d’Hannah Arendt, et qu’il avait pris connaissance de l’histoire d’Adolf Eichmann, ce criminel de bureau qui avec zèle et pour complaire à ses supérieurs avait envoyé des Juifs dans les camps de la mort sans états d’âme, il se méfiait du zèle. Lui, il n’était pas très malin c’est entendu, il se trompait sur le sens de la fureur de vivre c’est entendu, encore qu’il admirât James Dean et Gaspard de Besse, il était fasciné par ceux qui ont le chic avec les jolies femmes comme avec les voitures de luxe c’est entendu, mais au moins lui, il avait des états d’âme, lui il n’était pas un criminel de bureau, lui il n’avait pas de sang sur les mains – les autres radars non plus soit dit en passant – mais au moins il se posait des questions sur ce qu’il faisait et il abhorrait le zèle imbécile et aveugle. Enfin, l’honnêteté oblige à reconnaître qu’il se trompait sur le panache : il confondait le brio des spécialistes de l’épate qui roulent des mécaniques pour impressionner les jolies filles avec la grandeur du geste noble et désintéressé. Il le savait, il savait qu’il n’était pas très malin et il était fatigué. Alors, de guerre lasse, il envoyait à ses supérieurs des photos des voitures à la carrosserie désignée par Pininfarina prises en flagrant délit d’excès de vitesse avec la plaque d’immatriculation floutée, et il le faisait sciemment. C’était sa manière de se faire entendre, lui que personne n’écoutait jamais. Il savait qu’il n’était pas très malin et que c’était sans remède, alors il ne pouvait s’empêcher d’en rajouter dans la sottise.
Ce petit manège ne pouvait durer bien longtemps. En haut lieu, et en particulier à la direction de la Sécurité routière du ministère de l’Intérieur, ce n’étaient pas les fonctionnaires zélés, sanglés dans leur petit costume impeccable, au service d’une bureaucratie kafkaïenne, qui manquaient, et ils fulminaient sec.
— De quoi, disaient-ils. Nous avons sciemment mis en place une réglementation de plus en plus répressive, de plus en plus opaque, avec des normes contradictoires et parfois même en contradiction avec la hiérarchie des normes du grand juriste Hans Kelsen et surtout avec les traités européens – ce ne sont d’ailleurs pas les condamnations de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui manquent pour le prouver – exprès pour piéger les citoyens-automobilistes et faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’État, et ne voilà-t-il pas qu’un radar, un tout petit radar de rien du tout, sur le bord de sa départementale, s’avise d’ajouter son grain de sel ? Et il ne le fait même pas pour venir au secours des plus défavorisés, ce qui lui permettrait au moins d’invoquer des circonstances atténuantes ou un motif légitime s’il devait plaider sa cause… Mais il n’a rien compris celui-là ! Enfin, il ne perd rien pour attendre. Nous allons mettre en place un comité Théodule pour réfléchir à son cas et prendre les mesures qui s’imposent. Nous sommes dans une période de moralisation de la vie publique, et si nous pouvons admettre quelques entorses à la règle quand il s’agit de nos bien-aimés ministres, nous ne pouvons permettre qu’un radar, un tout petit radar de rien du tout, vienne mettre un grain de sable qui pourrait gripper les rouages de notre belle machine bureaucratique et kafkaïenne.
S’il avait eu vent de ces amères cogitations d’où naissent les postures avantageuses, les déclarations martiales et surtout l’héroïque décision de ne rien faire du tout, le petit radar qui n’était pas comme les autres aurait pu pousser un soupir de soulagement et continuer ses petites activités subversives comme si de rien n’était. Lui n’en savait rien mais nous, nous savons bien que l’administration, qui peut être d’une implacable intransigeance et d’une sévérité exemplaire dans ses relations avec le commun des mortels, perd toute son efficacité quand elle s’en remet à des commissions dominées par la réunionite aiguë et le souci de refiler la patate chaude à son voisin. Le petit radar aurait donc pu avoir une longue vie bien tranquille, sans jamais rien savoir de ce qui se tramait en haut lieu, si seulement il n’avait pas eu d’autres ennemis, bien moins puissants en apparence, mais animés par un inextinguible esprit de revanche et dotés de moyens beaucoup plus expédients, sur lesquels ils n’étaient pas toujours très regardants, dès lors qu’il s’agissait d’assouvir leur vengeance.
C’étaient les laissés-pour-compte du néocapitalisme triomphant. Leur composition sociale n’était pas homogène, il y avait là des ouvriers agricoles en situation irrégulière, des employés de l’industrie agroalimentaire au chômage, des petits patrons ruinés après la faillite de leur entreprise, des femmes au foyer bafouées, des animateurs de centres sociaux et culturels écœurés, des mères célibataires abandonnées par leur mari, des bénévoles aigris de voir leurs associations fermées par les départements alors que leurs présidents venaient de recevoir les subventions qu’ils étaient allés quémander auprès d’un Premier ministre qui, fraîchement nommé et mal soutenu par une majorité fragile, s’était empressé de leur donner satisfaction. Ils divaguaient sur les terres de Provence à la manière des routiers et des mercenaires débandés de l’ost royale qui vivaient au détriment de l’habitant en temps de paix à l’époque de la guerre de Cent Ans. Ils étaient les héritiers des défaites et des humiliations, celles de leurs parents, quand la gauche-caviar avait abandonné les ouvriers à l’époque de la désindustrialisation du Grand Est au profit d’investisseurs étrangers présentés comme des chevaliers blancs, qu’on appelait des « business angels » par abus de langage – il n’y avait strictement rien d’angélique ni de chevaleresque à vouloir faire des profits en rachetant à vil prix des entreprises françaises moribondes pour s’accaparer un savoir-faire ancestral relevant de leur patrimoine économique et immatériel – et celles qu’ils avaient personnellement vécues, notamment au moment de la révolte au cours de laquelle les gilets jaunes avaient incendié les boutiques de luxe de l’avenue des Champs-Élysées tous les samedis de l’hiver 2018-2019, une révolte que le pouvoir politique avait su mater avec le plus grand cynisme et sans satisfaire aucune des revendications pourtant légitimes exprimées à cette occasion : les taxes sur le carburant avaient continué d’augmenter, nulle institution n’avait été créée pour améliorer la démocratie directe, pas plus que n’avait été rétabli l’impôt sur la fortune ; le cynisme s’était traduit par les éléments de langage traditionnels de la langue de bois technocratique : en mars 2019, le président reconnaissait des « erreurs » dans sa gestion de la crise, ce qui était à tout le moins un euphémisme quand on sait que la répression policière, moyen privilégié par le pouvoir pour gérer la crise avec la loi anti-casseurs, avait été considérée comme une restriction « disproportionnée » au droit de manifester en France par la commission des Droits de l’Homme de l’ONU. Le 15 avril 2019, Notre-Dame était la proie des flammes d’un incendie d’origine probablement accidentel. Cinq ans plus tard, fin novembre 2024, à l’occasion d’une cérémonie célébrant la réouverture de la cathédrale après les travaux de restauration, le président, sanglé dans son beau costume de marque, remerciait tout le monde et parlait d’un « choc d’espérance ». Les laissés-pour-compte du néocapitalisme triomphant, alcooliques pour la plupart, minés par des affections diverses et des maladies dont la gravité se lisait sur les traits fatigués de leur visage, la rage au cœur de s’être faits flouer une fois de plus, avaient sans doute le droit d’y croire, mais dans la mesure où ils se considéraient comme les loyaux francs-tireurs d’une guerre civile qui ne finirait jamais, nous, nous savons bien que leur amertume était infinie, nourrie pas l’impossible oubli des humiliations qu’ils avaient subies. Animés plus que jamais par l’esprit de revanche, ils sillonnaient les routes de Provence à la recherche de radars automatiques à détruire, ces symboles d’un pouvoir honni. Ces derniers ne faisaient pas les fiers, et quand ils voyaient un groupe de gueux hétéroclites, ils se disaient bien que leurs intentions n’étaient pas bienveillantes. Alors, ils jouaient leur dernière carte : pour sauver leur peau, ils étaient prêts à dénoncer un petit radar de leur connaissance, un petit radar de rien du tout qui faisait le malin alors qu’il ne l’était pas, en floutant les plaques d’immatriculation des grosses cylindrées étrangères commettant des excès de vitesse sur la départementale conduisant à Saint-Rémy de Provence. Au prix de ce renseignement, le groupe de laissés-pour-compte du néocapitalisme triomphant acceptait de ne pas démonter le radar. Mais après plusieurs expéditions de ce genre, ils avaient plus qu’un faisceau de présomptions et d’indices, ils avaient acquis la ferme certitude qu’un petit radar de rien du tout se moquait d’eux et de leur détresse, en s’érigeant tout seul et alors qu’on ne lui avait rien demandé, en héraut de la lutte pour la défense des privilèges des nantis et des plus fortunés. Le jeune homme à l’air lunatique avait négligé de prévenir le petit radar que le Dictionnaire Superflu À L’usage de L’élite et Des Bien Nantis de Pierre Desproges, c’était du second degré, et le petit radar avait pris sa « mission » trop au sérieux. Il était seul désormais. Comme Gary Cooper dans Le train sifflera trois fois (High Noon, un film de Fred Zinnemann de 1956), il savait que le courage consiste à faire son devoir quoi qu’il en coûte et à affronter ses ennemis, les méchants, quand tout le monde a déserté autour de vous, et notamment ceux qui vous donnaient de précieux et judicieux conseils de sagesse et de prudence. Il ne pouvait pas bouger, alors il tenta d’affronter son destin avec vaillance ; il essaya bien de frimer, en se disant qu’il n’aimait pas ça, la vie, de toute façon, mais c’était faux, c’était un horrible mensonge, il avait aimé ça, la vie, dans ce qu’elle a de beau et d’horrible, dans ses moindres contradictions, la beauté du mal comme celle des petits riens qui rendent l’existence supportable dans les longues plages d’ennui, la beauté du diable comme la pureté de l’innocence. Il avait tout aimé de la vie, sauf, sauf, de faire comme les autres ; sauf, sauf, de se soumettre à la loi des autres ; sauf, sauf, de faire preuve de prudence quand la situation l’exigeait ; sauf, sauf, de se contenter de ce qu’on voulait bien lui donner, et de faire preuve de gratitude par-dessus le marché. Il allait maintenant falloir en payer le prix.
Ils arrivèrent en désordre, armés de leurs scies à métaux, et dans le silence de ce petit matin de décembre, quand le givre blanchit la campagne provençale qu’illuminent les premiers rayons du soleil qui surgit derrière le massif des Alpilles, leurs vociférations retentissaient :
— À mort, le traître ! On aura ta peau, salaud !
Ils empoignèrent leurs scies à métaux et ils le découpèrent au pied, à l’endroit où il était le plus fragile, puis ils le jetèrent dans le fossé, en contrebas de la départementale, non loin des iris de Van Gogh, de la terre ocre et des champs de lavande tels que les avait peints Paul Guigou et des paysans de Millet qui s’arrêtent au milieu de la moisson pour prier à l’heure de l’Angélus. Il tenta bien de résister, de se montrer stoïque tant qu’ils étaient là, mais quand ils se furent éloignés, l’abandonnant à son triste sort, agonisant, il put enfin s’abandonner et se souvenir.
Il se souvint de ce que lui avait raconté le jeune homme à l’air lunatique à propos de sa mère qui venait le réveiller en lui disant qu’il était un paresseux qui traînait au lit alors que la matinée était déjà bien avancée, sur les moments partagés avec les parents et les amis autour d’une bonne bouteille de vin, sur les plaisanteries échangées, parfois méchantes, parfois drôles, le plus souvent aigres-douces, sur les Noëls en famille, quand le jeune homme à l’air lunatique, encore enfant, découvrait les cadeaux au pied du sapin, les jouets, les bandes dessinées qu’en bon enfant gâté, il recevait par lots et ne pouvait s’empêcher de collectionner, animé par une frénésie de lecture, ainsi que les livres, dont la lecture était plus difficile, mais qui pour certains, lui rappelaient une personne chère : tel livre qui lui avait été offert par son grand-père, tel autre par sa cousine, et les petites cartes sur lesquelles était inscrit un mot gentil, auxquelles lui, le jeune homme à l’air lunatique, en raison de son désir de bien faire contrarié par sa maladresse, répondait parfois par un mauvais esprit déplacé. C’est qu’il ne savait pas faire preuve de méchanceté avec pertinence et à-propos, et il se souvenait de sa mère qui lui disait qu’il fallait faire taire le méchant en lui et faire ressortir le gentil.
Alors, le petit radar qui n’était pas comme les autres aperçut, entre les dernières branches, le soleil qui était déjà haut dans le ciel, et il comprit : il comprit que le jeune homme à l’air lunatique avait toute sa vie cherché, essayé d’être un homme, un vrai, mais qu’il était en fait resté un petit garçon, un petit garçon qui ne savait pas se débrouiller sans sa mère, un petit garçon qui n’avait jamais réussi à se départir de son admiration pour les écrivains qui avaient du style, qu’il s’agisse des prophètes réactionnaires qui invoquaient la peur de dieu pour défendre l’homme blanc contre le wokisme des nihilistes contemporains, ceux qui mettaient en garde contre les maux de la modernité (17), ou des écrivains progressistes qui, tel Antonio Tabucchi, traitaient de salauds les esthètes à la mode de Gabriele d’Annunzio (18). Là où sa petite sœur, marchant sur les traces de son père, s’était lancée dans la vie avec courage et enthousiasme, sans avoir peur des sensations fortes, celles que procurent le ski ou la navigation quand la mer est démontée et que le bateau frappe les vagues hautes, réussissant à fonder une famille en conciliant vie professionnelle et la charge mentale qu’implique le fait d’élever deux enfants en bas âge, lui était resté le petit garçon qui pleurait quand sa mère l’abandonnait à la rentrée de l’école primaire, le jeune adolescent capricieux qui voulait toujours imposer sa volonté aux autres, sans avoir toujours été capable de se soumettre à une discipline et à une hygiène de vie qui lui aurait permis de montrer l’exemple par un comportement sain et équilibré. Enfin, il était devenu un intellectuel à l’esprit vif, se posant sans cesse des questions, nostalgique des héroïnes romantiques de la littérature, la rebelle et narcissique Anna Karénine, la généreuse et négligente Lioubov Andreevna, mais aussi des actrices à la beauté vénéneuse comme Gene Tierney, fascinante dans Laura d’Otto Preminger (1944) et dans The Shanghaï Gesture de Josef von Sternberg (1941), ou la fragilité inquiète, révélatrice de blessures secrètes derrière la gaieté apparente et légèrement surjouée de Anita Ekberg dans Intervista (1987) de Fellini. Pour ce qui était du présent, il ne pouvait que s’en remettre au concept de déconstruction popularisé par Jacques Derrida, en s’appliquant à disséquer les mythes contemporains, et en particulier le plus galvaudé d’entre eux, celui de la femme parfaite.
Le petit radar se souvenait que le jeune homme à l’air lunatique, après avoir lu l’essai de Houellebecq sur Lovecraft, Contre le monde, contre la vie, paru en 1991, s’était cloîtré dans sa chambre, se prenant pour le reclus de Providence, et que ses parents l’avaient envoyé dans un hôpital psychiatrique, parce que tout ce qu’il avait réussi à faire, c’était de terroriser sa mère et sa petite sœur. Quand il en était sorti, il ressemblait à Alex, le personnage d’Orange mécanique (A clockwork Orange, le roman d’Anthony Burgess adapté au cinéma par Stanley Kubrick) adepte de l’ultraviolence et de Beethoven : tous ses amis s’étaient casés, ils avaient fondé une famille, ils étaient devenus flics ou fonctionnaires, de quoi attendre la retraite sans s’en faire, comme l’a chanté Jean Ferrat.
N'ayant que relativement réussi à devenir un héros romantique, il tenta de se reconvertir en intellectuel critique qui alerte le pouvoir sur les atteintes au patrimoine architectural parce que les victimes des atteintes à la dignité humaine, il les trouvait décidément surmédiatisées et bien jacassantes ; cependant la France se muséifiait, les centres-villes s’uniformisaient, et les restaurations étaient prétextes à des chantiers pharaoniques, que ne pouvaient se permettre que ceux qui disposaient de moyens colossaux, comme en témoigne la reconstruction de Notre-Dame, alors que les vieilles pierres, ici une bergerie à l’abandon, un cabanon isolé dans un champ de vignes, là une chapelle au sommet d’une colline surplombant le village, conservaient tout le charme des ruines romantiques ; il voulut se faire dandy désenchanté et repartit à l’étranger pour découvrir des civilisations radicalement différentes. C’est ainsi qu’il découvrit la Russie et ses artistes, non seulement les romanciers du XIXe, Pouchkine et son épouse convoitée par le tsar, auteur du roman en vers Eugène Onéguine (Евгений Онегин) (19), Gogol et son Journal d’un fou (Записки сумасшедшего), Lermontov, inconsolable après la mort du poète et qui se fera tuer comme lui en duel, auteur d’Un Héros de notre temps (Герой нашего времени), Gontcharov et son Oblomov, l’aristocrate Tolstoï, auteur de Résurrection (Воскресение) et de La mort d’Ivan Illitch (Смерть Ивана Ильича), et le roturier Dostoïevski avec ses Carnets du sous-sol (Записки из подполья), mais aussi les dramaturges du XXe siècle, à la verve iconoclaste, impitoyables dès lors qu’il s’agissait de dénoncer l’oppression politique, les incomparables Erdmann et Erofeïev, ainsi que les artistes pourfendant les dogmes du parti unique et de la loi du marché – et il trouvait que cela était bon, juste et sain, ces diverses manières de lutter contre l’éteignoir, de se battre pour proclamer son droit à vivre dans la liberté en revendiquant sa place au soleil.
Quand il revint dans une France qui ronronnait au milieu des affaires qui ne tournent pas rond, c’est ce qu’il eut envie de faire : revendiquer la pluralité de ses origines, de ses influences culturelles, en cultivant sa singularité, sa fantaisie et son enracinement. Il avait envie de respirer l’air pur des montagnes et de s’abîmer les yeux dans la contemplation de la mer d’azur qui baignait sa terre natale, de revoir la façade blanche des palaces de la colline de Cimiez, les arcades à l’italienne de la place Masséna, rouges comme le musée Matisse, entre les ruines archéologiques du site gallo-romain et le jardin du monastère franciscain, qui domine la route qui va vers Sospel et les villages de l’arrière-pays, Peille et Peillon, la vallée de la Roya et l’Italie, le musée du message biblique consacré à Marc Chagall, se promener dans les ruelles de la Vieille Ville, entre la place Garibaldi et les Neuf Lignes obliques (20), à l’ombre de la colline du château pour revoir la cathédrale Sainte-Réparate et se délecter des spécialités locales, la socca, la pissaladière, les ravioli à la daube, les « merda di can », ou la tourte de blettes sucrée, et du côté du port Lympia, qui lui rappelait des souvenirs d’enfance ainsi que sa découverte du musée de Terra Amata, construit en 1966 à l’initiative d’Henry de Lumley, sur les vestiges d’un campement de chasseurs d’éléphants qui vivaient là il y a 400 000 ans, prétexte à une méditation vertigineuse sur le temps, en fredonnant pour lui-même Nissa la Bella.
Le petit radar vit une dernière fois le soleil à travers les dernières branches, il eut une dernière pensée pour le jeune homme à l’air lunatique et il ferma les yeux. Le jeune homme à l’air lunatique, qui n’avait aucune raison de se plaindre, disposant des consolations de la musique, les grands airs de l’opéra italien comme les refrains des chansons à texte de ses compositeurs favoris, de la philosophie et de l’écriture, vint s’asseoir à côté du petit radar. Plutôt que de lui réciter des poèmes de Leopardi ou ses propres vers, il préféra l’entretenir d’un philosophe de la Renaissance.
C’est en effet dans la patrie de Montaigne que l’individu a appris le plus tôt, et de la façon la plus consciente, à se penser lui-même, non comme « un », mais comme « ondoyant et divers », comme pluriel, et partant, comme libre de se définir dans la multiplicité de ses possibles – le croyant, l’homme privé, le travailleur, le citoyen, l’artiste, etc.
Point d’hypocrisie ni de tricherie là-dedans. La capacité d’assumer la diversité de ses natures, sans cesser, pour autant, de se considérer comme responsable, fait le sage. Son incapacité fait le fou. Et son refus dessine l’idéal anti-humaniste du totalitaire, ou la réalité inhumaine du saint.
_____
(1) « Un jour, un voisin, qui était très gentil, m'a dit : « Oh, le joli petit bossu ! » J'ai demandé à ma grand-mère : « Qu'est-ce que c'est, un bossu ? » Alors elle m'a chanté une vieille chanson. Je me rappelle pas la musique, mais les paroles, ça disait comme ça : (il chante)
Un rêve m'a dit une chose étrange,
Un secret de Dieu qu'on n'a jamais su,
Les petits bossus sont de petits anges,
Qui cachent leurs ailes sous leurs pardessus.
Voilà le secret des petits bossus...
Les grand-mères, madame Rostaing, c'est comme le mimosa, c'est doux et c'est frais, mais c'est fragile. Un matin, elle n'était plus là. Une bosse et une grand-mère, ça va très bien, on peut chanter. Mai, un petit bossu qui a perdu sa grand-mère, c'est un bossu tout court. »
Marcel Pagnol, Naïs.
(2) À Venise, seule la piazza San Marco mérite le nom de “piazza”; les autres sont des « campi », et Carlo Goldoni s’en est inspiré pour sa pièce Il Campiello.
(3) Stravinsky n’a pas seulement composé L’Oiseau de feu et Le Sacre du Printemps (1913), avec lesquels il a contribué à inventer la modernité esthétique au début du XXe siècle, mais aussi Le Capriccio pour piano et orchestre (1929). Ce Capriccio, caprice en français, de l’italien « capra », la chèvre qui fait des bonds imprévus, témoigne que les influences culturelles des compositeurs sont multiples : après la modernité radicale du Sacre du Printemps, cette œuvre traduit un retour à la musique baroque, mais subit aussi l’influence de l’atmosphère des années 1920, Dada, le surréalisme…
(4) Contraction, en vénitien, de Santi Giovanni e Paolo.
(5) De l’italien « condotta », contrat de louage.
(6) La Fenice, en français « le Phénix », l’oiseau de la mythologie grecque qui renaît de ses cendres, a connu deux incendies, en 1836 et en 1996, et deux réouvertures, dont la dernière en 2003, après des travaux de reconstruction à l’identique.
(7) Le 221B Baker Street est l’adresse de l’appartement londonien de Sherlock Holmes, le célèbre détective privé inventé par Conan Doyle.
(8) Pourquoi les « Cinq de Cambridge » (Cambridge Five ou Magnificent Five en anglais), dont le célèbre Kim Philby, ont-ils trahi leur pays dans les années 1930, la Grande-Bretagne, patrie de la démocratie libérale, conservatrice en matière sociale et politique, caractérisée par de fortes disparités de classes, au profit de l’U.R.S.S. ? Recrutés par le N.K.V.D., l’ancêtre du K.G.B. devenu F.S.B., il semble désormais avéré qu’ils ne l’ont fait ni par appât du gain, ni par intérêt personnel, mais poussés par une foi absolue dans l’idéal communiste.
… Notons au passage que nombre d’anciens cadres du KGB, comme l’actuel président russe Vladimir Poutine, se sont reconvertis dans la nouvelle économie de marché russe et la politique, démontrant ainsi que celles-ci ne leur pose pas beaucoup de cas de conscience.
(9) Français, encore un effort si vous voulez être républicains est le cinquième dialogue de La Philosophie dans le boudoir.
Rappelons que le marquis de Sade a passé plus de la moitié de sa vie en prison, parce que le pouvoir ne lui a pas pardonné son œuvre nourrie de violence érotique, de « délire du vice » et de pornographie. Ce n’est qu’au milieu du 20e siècle qu’elle a été partiellement réhabilitée, dans la mesure où cette œuvre fait encore l’objet de polémiques. En 2014, le philosophe Michel Onfray faisait paraître La passion de la méchanceté. Sur un prétendu divin marquis, dans lequel il s’en prenait à Georges Bataille, André Breton, Roland Barthes, Jacques Lacan, Gilles Deleuze et Philippe Sollers, coupables à ses yeux de considérer le marquis de Sade comme un philosophe visionnaire, défenseur de la liberté de penser.
La première question pourrait être : le marquis de Sade était-il un féodal royaliste, misogyne et violent, ou un libérateur du genre humain ? Et la seconde : Michel Onfray est-il un redoutable polémiste ou un simple intellectuel médiatique ? Étant donnés ses succès de librairie, j’ai tendance à voir en lui un philosophe à vendre… auquel je préfère Eduardo Filippo dans le rôle du professeur Ersilio Micci, dans le dernier sketch du film de Vittorio De Sica, L’or de Naples (L’Oro di Napoli, 1954) : celui-ci « vend » de la sagesse ; autrement dit, il apprend aux habitants de son quartier pauvre de Naples à répondre à un aristocrate hautain et méprisant, qui les accuse de gêner le passage de son automobile quand il rentre chez lui, en faisant un « pernacchio », un bruit particulièrement déplaisant effectué avec la bouche : il leur apprend ainsi à répondre au mépris par la dérision plutôt que par la violence… sagesse du petit peuple napolitain.
Je me souviens d’avoir visité le château de Lacoste, dans le Luberon, qui fut la propriété du marquis de Sade, d’où la vue sur la plaine et les villages environnants, avec les monts de Vaucluse en arrière-plan, est splendide ; il est exact que je n’aurais pas détesté visiter le château de Caserte, dans les environs de Naples, ou la grotte du Pausilippe, où se trouve le tombeau de Virgile ; mais j’ai eu la chance de visiter le musée archéologique, le musée des Beaux-Arts de Capodimonte, la piazza del Plebiscito, entre la Basilica San Francesco da Paola et le Palazzo Reale ; un peu plus loin, sous la statue d’Auguste, la vue sur le Castel dell’Ovo, le port et la baie de Naples, ainsi que sur l’île de Capri dans le lointain et sur le Vésuve, est superbe.
Mentionnons les films qui traitent des relations entre les affairistes et la classe politique, sur lesquelles plane l’ombre menaçante de la Camorra : Main basse sur la ville (Le Mani sulla città, 1963) de Francesco Rosi, Gomorra (2008) de Matteo Garrone d’après le livre de Roberto Saviano, et le trop méconnu à mon goût Fortapàsc (2009) de Marco Risi : rappelons qu’il raconte l’histoire de Giancarlo Siani, jeune journaliste abattu le 23 septembre 1985 de dix balles de revolver, très vraisemblablement parce qu’il s’intéressait de trop près aux activités douteuses du capo de Torre Annunziata, dans le cadre des travaux de reconstruction après le tremblement de terre de 1980. Il avait vingt-six ans.
À propos de Georges Bataille, je me souviens d’avoir visité la bibliothèque Inguimbertine à Carpentras, dont il fut le bibliothécaire, et d’avoir lu son court roman Histoire de l’œil quand j’étais étudiant, une histoire particulièrement incandescente, et le mot est faible.
Quant à Philippe Sollers, je lui suis reconnaissant d’avoir été un admirateur d’Ezra Pound, de Venise, et d’avoir publié un Dictionnaire amoureux de Venise (2004), dans lequel il y a beaucoup à apprendre, à voir et à sentir.
(10) J’ai longtemps adhéré au jugement de Cioran sur Camus : « Un philosophe pour classe de Terminale », peut-être parce qu’Albert Camus avait lui-même eu un jugement lapidaire sur Schopenhauer. Je dois reconnaître qu’il fut un grand écrivain, mais entre toutes ses œuvres, je choisirais Les Justes, sa pièce de théâtre représentée pour la première fois le 15 décembre 1949 au théâtre Hébertot : l’histoire est celle d’un groupe de socialistes révolutionnaires qui, en 1905, projette d’assassiner le grand-duc Serge qui gouverne la ville de Moscou en despote, inspirée d’un fait réel en lien avec la révolution de 1905. Pourquoi ce choix ? Parce que cette pièce me pose un problème, tout comme la violence des socialistes révolutionnaires, parfois qualifiés d’anarchistes nihilistes. En théorie, je crois que l’anarchie est le meilleur des régimes politiques, devant la monarchie et la tyrannie (gouvernement d’un seul, la tyrannie étant une dégénérescence de la monarchie), l’aristocratie et la ploutocratie (gouvernement à plusieurs, les « meilleurs » dans le cas de l’aristocratie, ces « meilleurs » se distinguant par leur richesse dans le cas de la ploutocratie), et la démocratie (dont Churchill affirmait qu’elle était le pire des systèmes de gouvernement, à l’exception de tous les autres : une boutade qui a du sens, elle signifie que si la démocratie n’est pas parfaite, elle est le moins mauvais de tous les systèmes), mais dans la pratique… je suis bien obligé de constater que la violence politique des anarchistes la condamne. Je ne prendrai qu’un seul exemple : l’assassinat du tsar Alexandre II, le 13 mars 1881, à l’endroit où a été construite depuis l’église collégiale que l’on appelle Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé (en russe : Храм Спаса на Крови ; mais son nom officiel est cathédrale de la Résurrection du Christ, en russe, Собор Воскресения Христова) par des membres de l’organisation politique Narodnaïa Volia (« Volonté du peuple », en russe). Or, le tsar Alexandre II n’était pas un despote, en tout cas ce n’était pas le plus autocratique des tsars : c’est à lui qu’on doit l’abolition du servage en Russie, en 1861, dans le but de permettre la vente des terres agricoles aux serfs affranchis ; Alexandre II a ainsi émancipé les 22 millions de serfs de l’Empire russe le 3 mars 1861.
Ce fait me pose une question : pourquoi sont-ce les plus libéraux des hommes d’État, et non pas les psychopathes sanguinaires, qui se font assassiner ? Pourquoi sont-ce les hommes qui prônent la paix, comme Gandhi, comme Martin Luther King, comme Itzhak Rabin, et non ceux qui prêchent la haine ? Je n’ai pas la réponse. Je n’ai qu’une hypothèse : Il est plus difficile de croire en l’homme que de se méfier des bas instincts de la foule, de l’humanité en général ou des déséquilibrés isolés. Les psychopathes sanguinaires sont généralement plus paranoïaques que les hommes d’État libéraux ; ces derniers croient en l’homme, ils agissent au nom de leur foi en celui-ci. Ils agissent donc comme des prophètes désarmés, ils sont plus vulnérables.
(11) Idiosyncrasie : du grec ancien ἰδιοσυγκρασία, idiosunkrasia : « tempérament particulier », formé de ἴδιος, ídios : « propre » ou « particulier », σύν, sún : « avec », et κρᾶσις, krâsis : « mélange ».
L’idiosyncrasie désigne le comportement particulier, la « personnalité psychique », propre à un individu. Parler d’idiosyncrasie individuelle, ou personnelle, revient donc à employer un pléonasme. Parler de l’idiosyncrasie d’un peuple, comme je le fais, peut être considéré comme une impropriété ; je préfère considérer qu’il s’agit d’une licence poétique, ou de l’invention d’un poncif.
(12) Comme on peut les voir dans le film Riz amer (1949), de Giuseppe De Santis, avec Silvana Mangano dans le rôle-titre.
(13) La grande-tante du jeune homme à l’air lunatique était un fin cordon bleu, qui ne lui mitonnait pas seulement de « bons petits plats » à la va-vite, elle avait un respect presque religieux de l’art culinaire : l’omelette de la mère Poulard, le beurre blanc de la mère Clémence dans son restaurant de la Chebuette près de Nantes, les recettes de la mère Brazier et les spécialités lyonnaises n’avaient pas de secret pour elle. Elle n’avait qu’un défaut : elle ne pouvait se départir d’un léger dédain envers la gastronomie provençale, et pour l’aïoli en particulier. Bien que cela chagrinât notre gourmet gourmand, celui-ci, en bon disciple de Curnonsky, n’avait qu’une chose à dire : nul(le) n’est parfait(e). Pour l’aïoli, il irait voir ailleurs ; il y avait d’ailleurs été, et s’il avait eu l’occasion de fréquenter des restaurants étoilés ou des tables accueillantes, de goûter à des plats raffinés, exotiques ou simplement roboratifs, jamais il n’avait retrouvé ce qui faisait la saveur et le charme particuliers de la cuisine de sa grande-tante… Pour simplifier, il dirait volontiers qu’elle avait porté à un niveau rarement égalé la gastronomie bourgeoise. Eh oui, il avait aussi ses petites contradictions, notre ami le jeune homme à l’air lunatique.
(14) Joseph d’Arbaud, La Bête du Vaccarès.
Frédéric Mistral, Mireille (Mireiò), Les Îles d’or.
Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon, Les Lettres de mon moulin, mais surtout Les contes du lundi, dans lesquels il évoque les coteaux de Nogent-sur-Marne après la défaite contre la Prusse dans la guerre de 1870. Quant à ma grand-mère maternelle, elle aimait beaucoup La dernière classe, un récit extrait des Contes du lundi, sans doute parce que s’y exprime un patriotisme tout en nuances, et un regret, celui de n’avoir pas assez insisté sur l’instruction. C’est l’histoire d’un petit Alsacien, Frantz, qui a peur d’être grondé parce qu’il ne sait pas ses participes mais qui a quand même la force d’aller en classe. Là, l’instituteur, M. Hamel l’appelle au tableau pour l’interroger, il y va et ne peut réciter ses participes ; il a le cœur gros parce qu’il vient d’apprendre que le français ne serait plus enseigné, l’ordre est venu de Berlin, et il aurait voulu donner cette satisfaction et ce réconfort à son maître. À sa grande surprise, il ne se fait pas gronder ; estimant qu’il est suffisamment puni comme ça, l’instituteur, au contraire, insiste sur les fautes des adultes : les parents qui ne tenaient pas à voir leurs enfants instruits, préférant les envoyer travailler à la terre ou aux filatures, et lui-même, qui leur a parfois demander d’arroser son jardin au lieu d’étudier, ou leur donnant congé pour aller pêcher la truite. Comment cela se termine-t-il ? Par un éloge d’une valeur qui nous dépasse et nous transcende, qui nous oblige à nous hisser au-dessus de nous-mêmes : contre le nationalisme étroit et imbécile, le patriotisme c’est l’amour de cette France qui se définit par sa langue, dans le respect de ces étrangers, artistes célèbres ou immigrés anonymes, qui ont forgé son identité culturelle et ont été les soutiers de sa prospérité économique.
Réécoutons Ma France de Jean Ferrat : ceux qui ne sont pas émus aux larmes par cette chanson ne sont pas mes amis.
(15) Le Caïman de Nanni Moretti est sorti en Italie en mars 2006, soit juste avant les élections parlementaires qui se sont tenues les 9 et 10 avril et qui ont vu la victoire, à une courte majorité (49,81 % contre 49,71 % des voix), de la coalition de gauche emmenée par Romano Prodi sur celle de droite conduite par Silvio Berlusconi. Le gouvernement Prodi, formé en mai 2006, s’est maintenu jusqu’au 8 mai 2008 : c’est donc l’équipe nationale d’une Italie gouvernée à gauche qui a remporté la coupe du monde, le 9 juillet 2006, dans le stade olympique de Berlin, contre l’équipe de France. Oserais-je le dire ? Mes amis, c’est l’instant présent qu’il faut vivre avec intensité – car, décidément, les parenthèses enchantées ne durent jamais vraiment longtemps. Quant à l’Italie, elle ne fera jamais rien comme les autres : « L’Italia farà da sé » est le motto par lequel Charles-Albert introduisit sa proclamation aux peuples de Lombardie et de Vénétie le 23 mars 1848, à l’époque du printemps des peuples ; cette devise fut plus tard reprise à son compte par Garibaldi. Lors de la campagne électorale de ces élections parlementaires d’avril 2006, Romano Prodi déclara : « Berlusconi s’accroche au pouvoir comme un ivrogne à son réverbère », une phrase qui a quand même un peu plus de classe que « Il vaut mieux être fasciste que pédé » (Alessandra Mussolini) ou « Le programme de l’Union [la coalition de gauche] sent la vaseline » (Umberto Bossi), et qui n’a rien perdu de son actualité : suivez mon regard…
(16) Dans son livre Le Crépuscule des idoles, Nietzsche emploie le terme d’idiosyncrasie pour désigner une attitude liée au nihilisme moderne : l'être humain construit des arrières-mondes (le paradis par exemple) pour s'y réfugier, et dénigre ce faisant le monde réel. Cette fuite est en même temps un mécanisme de défense face au caractère tragique de l'existence. C'est ce mécanisme qui prend le nom d'idiosyncrasie, et dont le penseur retrace la présence chez certains philosophes antiques, notamment Socrate, lorsqu'avant de mourir il énonce « nous devons un coq à Asclépios », montrant par là, selon Nietzsche, une forme de nihilisme qui considère la vie comme une sorte de maladie.
Alors certes, on pourrait réduire Socrate à la formule inscrite sur le fronton du temple de la Pythie de Delphes : « Connais-toi toi-même » (« Gnothi seauton ») ; dans mon cas, je ne suis pas sûr que cela simplifierait les choses. Mettons que ce soit une invitation à se garder de l’« hubris » et de la démesure, et insistons bien sur le mot « invitation », parce que si « savoir raison garder » est une expression qu’il m’arrive d’employer, je ne suis pas certain de l’avoir mise en pratique avec constance tout au long de ma vie. Je suis même certain du contraire.
(17) Georges Bernanos, La France contre les robots, 1944, dans lequel il traite pour la première fois de ce qu’il appelle « l’homme des machines » : après avoir dénoncé un monde tout entier voué à l’Efficience et au Rendement, il déplore que la civilisation des machines et leur multiplication fabrique des hommes habitués, dès leur enfance, à ne désirer que ce que les machines peuvent donner.
(18) Le terme de « salaud » a plusieurs sens. Dans son sens courant, il désigne celui qui se comporte égoïstement, sans égards pour les autres (à distinguer de l’égotisme stendhalien, qui consiste à trouver sa jouissance dans la contemplation des œuvres d’art, comme en témoigne la polémique avec Wincklemann sur la définition de la beauté : absolue chez Wincklemann, relative chez Stendhal, ce qui n’empêche pas ce dernier de tenter de définir le « Beau idéal moderne » dans son Histoire de la peinture en Italie. On trouve un renouvellement de cette tentative dans l’Histoire de la Beauté (2004) d’Umberto Eco, dans laquelle l’auteur, après s’être interrogé sur ce qu’était l’art, le goût, la mode, dresse un état des lieux des multiples facettes de la Beauté, de la Grèce antique à nos jours, en passant par les monstres de Jérôme Bosch et les madones de Botticelli. Disons, pour simplifier, qu’une définition accessible de la beauté désigne ce qui plaît sans concept).
En philosophie, le « salaud » est celui qui croit que la vie a un sens prédéterminé. C’est ainsi que le jeune homme à l’air lunatique méprisait souverainement les bourgeois installés dans l’existence, qui du haut de leurs certitudes morales, se comportaient comme des philistins envers les œuvres d’art, celles qui ennoblissent la vie, en permettant à l’homme de se hisser au-dessus du kitsch des objets de la consommation de masse : après avoir lu une pièce comme le Platonov de Tchekhov, un roman comme Moscou heureuse de Platonov, ou les Aphorismes sur la sagesse dans la vie de Schopenhauer, après avoir pu contempler l’Apollon du Belvédère, le Gladiateur Borghese, le Laocoon ou le Moïse du tombeau de Jules II par Michel-Ange, après avoir entendu un air de Count Basie ou de John Coltrane, il se sentait un homme meilleur, vivifié par un souffle nouveau, prêt à affronter les turpitudes de la vie en société, et notamment les récriminations et la mauvaise humeur des éternels esprits toxiques, comme les rodomontades des actrices à l’ego boursouflé qui, effectivement, ne manquaient pas d’air… comme les baudruches.
(19) Mis en musique par Tchaïkovski, dans un opéra en trois actes de 1878.
(20) Œuvre de l’artiste Bernar Venet, installée face à la Promenade des Anglais en 2010, à l’occasion du 150e anniversaire de l’annexion du comté de Nice à la France, elle symbolise les neuf vallées de l’arrière-pays qui formaient l’ancien comté de Nice.
Je me contenterai de mentionner le fleuve côtier de la Roya, ainsi que deux affluents du Var, la Tinée et la Vésubie, le Var étant ce fleuve côtier qui marquait la frontière entre la Provence et le comté de Nice avant l’annexion.
Décembre 2024.