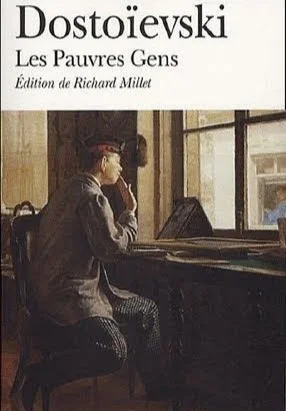Quel effet la pauvreté produit-elle sur l’esprit ?
Ce jour-là, Antoine avait dîné dans une brasserie chic aux abords de la gare Saint-Lazare. Il aurait volontiers pris une bière en terrasse face à la circulation du boulevard Malesherbes, sur la place Saint-Augustin, comme un acteur de cinéma frimant au milieu de la faune, mais son ami Paolo qui sortait d’une journée épuisante au bureau où il avait déménagé des archives avait besoin de calme et ils avaient donc opté pour un troquet dans le passage Courdeaux où ils s’étaient fait voler comme d’habitude. Antoine était allé lire les Pensées de Leopardi dans le square Louis XVI en l’attendant. Ce square, il le connaissait bien : il le fréquentait à l’époque où il attendait sa mère à la sortie du bureau du temps où elle travaillait pour Indosuez et qu’elle lui racontait des anecdotes tirées de ses conversations avec son ami breton qui lui parlait de la radioactivité du granit.
Quelques Pensées de Leopardi avait retenu toute l’attention d’Antoine tandis que sur le banc d’à côté, des jeunes à l’empathie toute étudiée flattaient le chien d’une mégère en lui affirmant qu’il avait bien raison de mordre, il faut savoir se défendre dans la vie :
Pensée LXX : « Ces erreurs, qualifiées d’enfantillages, que commettent non seulement les jeunes gens inexpérimentés, mais aussi ceux qui, jeunes ou vieux, sont condamnés par la nature à être plus que des hommes et à passer toute leur vie pour des enfants, résultent en fin de compte de ce préjugé qui consiste à croire les hommes plus dégagés de l’enfance qu’ils ne le sont. Et certainement, ce qui d’emblée surprend le plus un jeune adulte éduqué dans les règles quand il fait son entrée dans le monde, c’est la frivolité des occupations, des passe-temps, des propos, des goûts et des caractères. Peu à peu, bien sûr, il s’y habituera, non sans difficulté cependant, car il lui semble très justement qu’on l’oblige désormais à redevenir un enfant. En effet l’on exige du plus doué des jeunes gens, pour ce qu’on appelle ses débuts dans la vie, de faire machine arrière et de sacrifier à la puérilité ; il est alors bien détrompé, lui qui s’imaginait devoir se faire pleinement adulte et se dépouiller des derniers traits de l’enfance. En fait, malgré les années qui s’écoulent, les hommes ne cessent point de vivre, à maints égards, en véritables enfants. »
« Questi errori, descritti come puerilità, commessi non solo da giovani inesperti, ma anche da coloro che, giovani o vecchi, sono condannati per natura ad essere più degli uomini e a spendere tutta la loro vita per i bambini, risultano in ultima analisi di questo pregiudizio che consiste nel credere che gli uomini siano più liberati dall'infanzia di quanto non siano in realtà. E certamente, ciò che più sorprende un giovane adulto educato alle regole quando entra nel mondo, è la frivolezza delle occupazioni, dei passatempi, delle parole, dei gusti e dei caratteri. A poco a poco, naturalmente, si abituerà, non senza difficoltà, però, perché gli sembra molto giustamente che ora sia costretto a tornare bambino. Infatti, ai giovani più dotati è richiesto, per quelli che vengono chiamati i loro inizi nella vita, di fare marcia indietro e sacrificare all'infanzia; è allora ben disingannato, lui che immaginava di dover diventare pienamente adulto e spogliarsi degli ultimi tratti dell'infanzia. Infatti, nonostante il passare degli anni, gli uomini non cessano di vivere, per molti aspetti, come bambini veri. »
Pensée LXXI : « De cette idée des adultes que se fait tout jeune homme, à savoir qu’ils seraient plus adultes qu’ils ne le sont, provient l’habitude de s’effrayer à chaque faux-pas qu’il commet et de croire qu’il a perdu l’estime de tous ceux qui en ont été les témoins ou en ont eu connaissance. Puis le voilà qui se rassérène peu à peu, quand, non sans surprise, il se voit traité exactement comme avant. En fait les hommes ne sont pas si prompts à retirer leur estime, car il y aurait sans cesse à le faire, et ils oublient les erreurs, car ils en voient et en commettent beaucoup trop d’affilée. Ils ne sont pas non plus figés au point d’être incapables d’admirer aujourd’hui celui dont ils se gaussaient hier. Cela saute aux yeux si l’on se rappelle toutes les occasions où nous avons brocardé ou critiqué, en termes parfois très durs, tel de nos amis en son absence, sans pour autant qu’il soit privé de notre estime ou traité de façon différente lorsqu’il se trouve de nouveau devant nous. »
« Da questa idea di adulti che ogni giovane ha, cioè che sono più adulti di quello che sono, nasce l'abitudine di spaventarsi ad ogni passo falso che commette e di credere di aver perso la stima di tutti coloro che l'hanno visto o saputo. Poi eccolo che si calma a poco a poco, quando, non senza sorpresa, si vede trattato esattamente come prima. Gli uomini, infatti, non sono così pronti a ritirare la loro stima, perché ci sarebbe sempre da farlo, e dimenticano gli errori, perché ne vedono e ne commettono troppi di seguito. Né sono congelati al punto da non poter ammirare oggi quello di cui ridevano ieri. Questo è evidente se ricordiamo tutte le occasioni in cui abbiamo schernito o criticato, talvolta in termini molto aspri, un nostro amico in sua assenza, senza che venisse privato della nostra stima o trattato diversamente quando è di nuovo davanti a noi. »
Antoine en déduisait que les hommes ont bien du mal à sortir de l’enfance.
Cela concordait avec l’expérience qu’il venait de faire dans le troquet où on lui avait vendu un verre de vin 13 euros 50. Cela correspondait aussi à son expérience de la vie : d’un côté, les génies du passé, sympathiques parce qu’ayant gardé une âme d’enfant, de l’autre, les représentants des hautes classes de la société contemporaine, sinistres et grotesques à force de vouloir faire passer leurs malversations pour des peccadilles.
La pauvreté a pour premier effet de produire de l’envie : à force de voir les autres ne pas se gêner, on éprouve le besoin de s’offrir un petit plaisir sans regarder à la dépense, quitte à le regretter ensuite. Surtout quand comme Antoine, on a un rapport désinvolte à l’argent.
Premier point : la liberté a pour corollaire la responsabilité. Le rapport irresponsable qu’Antoine entretenait avec l’argent permettait d’affirmer qu’il n’était pas libre.
Il n’était du reste pas non plus libre du fait qu’il avait intégré les normes de la correction politique contemporaine bien qu’il eût lu les livres des auteurs les plus transgressifs et les plus subversifs du XXe siècle : Fernando Pessoa, Cioran par exemple.
Enfin, il n’était pas libre parce qu’il était sujet, comme ses contemporains, à la versatilité des opinions : il avait lui aussi l’habitude de brûler ce qu’il avait encensé la veille ou dans sa jeunesse. Le seul point à peu près stable résidait dans son admiration pour les écrivains réactionnaires et les penseurs pessimistes comme Schopenhauer et Leopardi. Ainsi que pour la satire des mœurs contemporaines qu’il avait trouvé dans le cinéma d’auteur, italien notamment.
La pauvreté engendre également de l’aigreur et du ressentiment, non seulement à l’égard des célébrités mais aussi envers les cercles d’éminences grises proches du pouvoir. Oscar Wilde a un jour écrit qu’il ne fallait pas dire du mal de la belle société car c’était le signe qu’on n’en faisait pas partie. Eh bien, Antoine et Paolo n’en faisaient pas partie, alors ils daubaient sur les chanteurs basanés de la scène musicale qui éclipsaient Verdi ou Puccini ainsi que les auteurs-compositeurs de canzonette italiane qui leur rappelaient le pays natal. En bons mélomanes, ils se gardaient de les oublier, car elles les consolaient d’avoir les oreilles salies et le goût corrompu par le vacarme et le rythme binaire de la pop rock contemporaine.
Ils daubaient également sur les sportifs qui se livraient aux incongruités et aux caprices les plus navrants parce qu’ils étaient millionnaires et ne se préoccupaient que de leurs contrats publicitaires. Leur image n’en était pas affectée, signe de l’aliénation de leurs fans et des contemporains d’Antoine et Paolo.
Au milieu des colorés et des femmes névrosées, ils discutaient de sujets les plus variés : des femmes et des mosaïques de Ravenne, du prix des péages qui avait fait un bond vertigineux ces cinq dernières années (Antoine en était resté à 45 euros pour aller de Paris à Nice, c’était aujourd’hui plus du double), permettant aux actionnaires de se gaver et les obligeait eux à faire attention : ils ne pouvaient pas aller en Italie, ni même à Nice aussi souvent qu’ils l’auraient voulu. Ils discutaient également de l’actualité internationale. Ils ne savaient pas très bien quelle était la stratégie de Poutine en Ukraine après seize mois d’enlisement. Eux-mêmes étaient lassés par cette guerre, principalement en raison de la fermeture des frontières et de la difficulté à obtenir un visa qui en résultaient. Sans être des inconditionnels du dirigeant russe, ils tenaient à leur liberté de voyager et à l’ouverture d’esprit sur les cultures autres que la leur. Paolo projetait un voyage en Ouzbékistan et au Kirghizistan, pour lesquels un visa n’était pas obligatoire, pour découvrir un pays musulman. Antoine qui, in petto, pensait que pour visiter un pays musulman, il suffisait de rester en France, lui avait conseillé d’aller visiter l’exposition de l’Institut du Monde Arabe consacrée aux splendeurs et trésors de Samarcande (Ah Samarcande ! Marco Polo ! le tombeau de Tamerlan, le mausolée de Gour Emir ! Lui-même regrettait cependant de ne pouvoir retourner en Russie où il avait été si heureux).
Il leur semblait que Poutine était de plus en plus isolé, lâché par ses alliés d’hier, la Turquie et la Chine, soucieuses de continuer à faire du business avec l’Occident.
Ils remarquaient alors qu’Israël était bien silencieux sur le sujet de la guerre en Ukraine. La conversation d’Antoine et Paolo s’aventurait sur un terrain glissant : les juifs.
Antoine avait pourtant lu des romans comme Le Cimetière de Prague d’Umberto Eco (2011) dans lequel l’universitaire italien dénonçait le protocole des Sages de Sion comme un faux fabriqué par les antisémites, tels Edouard Drumont auteur de La France juive. Edouard Drumont avait un confesseur ; Antoine n’avait pas de confesseur, il avait une psy plutôt compréhensive à l’égard de ses erreurs.
Antoine maîtrisait moins qu’il ne jonglait avec les concepts de judaïsme, de sionisme, d’antisionisme et d’antisémitisme, et si tous lui étaient plus ou moins familiers, il remarquait surtout qu’il était bien difficile de critiquer les opinions d’un intellectuel juif en vue sans passer pour antisémite.
Il se rappeler avoir planché quand il était étudiant sur La Mondialisation heureuse d’Alain Bic, ouvrage qui faisait l’apologie de la mondialisation libérale et sommait les citoyens comme les entreprises de s’adapter à cette nouvelle donne, nouvelle donne toute relative puisque dans son ouvrage sur la Méditerranée, Fernand Braudel rappelait que la mondialisation avait commencé au moins au XVIe siècle, si ce n’est avant, comme en témoignait les échanges commerciaux à Samarcande (Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II, 1949).
Jacques Athala, le courtisan et hagiographe de François Mitterrand, avait également rédigé un rapport sur la libéralisation des taxis parisiens, rapport envoyé à la poubelle après une manifestation de cette corporation.
BécHameL n’était pas seulement l’auteur d’un film niais, d’ouvrages à la gloire de sa personne et le mari d’une actrice vieillissante, maquillée comme une voiture volée. Du temps de la présidence du clone de De Funès, c’était lui l’instigateur de la guerre en Lybie visant à destituer le président Khadafi, auparavant bien en cour auprès des chancelleries occidentales.
Alain Bic, Jacques Athala et BécHameL étaient des apôtres de la libéralisation de l’économie, mais ils savaient se tenir prudemment à l’écart quand montait la colère populaire. Ça n’avait bien sûr aucun rapport avec leurs origines, ni à leurs réseaux dans les cercles du pouvoir. C’étaient des intellectuels français, favorables à la libéralisation des professions des autres et surtout des économiquement faibles, gérant leurs propres affaires comme des capitalistes prospères, leur villa dans le Luberon, et régulièrement invités sur les plateaux de télévision où ils parlaient d’amour, commentaient l’actualité nationale et internationale, jouaient les Cassandre et les ouin-ouins pleurnichards face à des journalistes complaisants, trop soucieux de leur image et de leur mèche de cheveux pour apporter une contradiction qui ne soit ni molle ni purement rhétorique.
Antoine et Paolo étaient perplexes. Il était difficile de rien dire sans risquer de tomber dans la paranoïa du complot judéo-maçonnique.
Antoine se rappelait qu’il avait eu un prof quand il était étudiant qui les exhortait à refuser la contre-culture américaine. Lui-même fondateur de l’Observatoire du religieux et conseiller du Prince, il était un fervent partisan de l’Islam de France et de l’intégration des musulmans, qu’il considérait comme un rempart contre la radicalisation et les dérives terroristes. L’actualité des vingt premières années du XXIe siècle ne lui avait pas donné raison, elle regorgeait d’exemples de radicaux faisant exploser des bombes pour tuer des innocents. C’est qu’Antoine n’était pas le seul à raisonner par généralités : son prof aussi, par ailleurs accaparé par ses activités de conseiller, n’ayant sans doute pas eu le temps d’étudier à fond Le livre du courtisan de Balthasar Castiglione.
Ce prof était lui-même franc-maçon. A l’époque, ce n’est pas ce qui gênait Antoine ; ce qui le gênait, c’est qu’on trouvait toujours des excuses à la délinquance des racailles des cités tandis que les étudiants blancs comme Antoine étaient considérés comme des privilégiés par leurs profs qui leur faisaient honte de leur admiration pour les modèles culturels venus d’Outre-Atlantique. Il est vrai qu’Antoine n’admirait pas seulement les romans de Philip Roth et les films de Woody Allen, que les livres de Paul Auster l’emmerdaient royalement comme ceux d’Henry James et d’Edith Wharton sauf quand ils parlaient d’Italie (d’Henry James, il préférait L’automne à Florence au Tour d’Ecrou et aux best-sellers d’Edith Wharton, Ethan Frome ou Le temps de l’innocence. La vie des puissants de la belle société bostonienne, avec leurs états d’âme, était aussi ennuyeuse que celle des aristocrates londoniens, comme l’a décrit Virginia Woolf dans Mrs. Dalloway). Il préférait surtout le roman de Bret Easton Ellis, American Psycho, mettant en scène un yuppie psychopathe dans le Wall Street des années Reagan, satire du monde de la finance. Antoine avait lui-même quelques affinités avec ce psychopathe : face au clodo de son quartier, qui puait et réclamait toujours des cigarettes, il pensait à Patrick Bateman injuriant un SDF de Wall Street en souvenir de Baudelaire considérant qu’il s’agissait là d’un bon moyen d’inciter les pauvres à la révolte. Il détestait les nègres, il détestait les arabes (en particulier les sportifs et les célébrités millionnaires), il détestait les vieilles rombières ménopausées imbues d’elles-mêmes et donneuses de leçons, il détestait les prolétaires comme les bourgeois qui se reproduisent sans même être capable de donner une éducation correcte à leurs enfants, ils détestait les gosses de riches qui fréquentent des écoles privées, il détestait les youpins, y compris et surtout ceux qui écrivent des livres (à commencer par Marcel Proust, mais aussi Jankélévitch, parce qu’il ne pouvait pas faire la morale au pouvoir politique sur les enjeux éthiques majeurs de notre époque, il détestait également ce Clément Viktorovitch qui avec son Pouvoir rhétorique avait rédigé un manuel de manipulation à l’usage de l’elite et des bien nantis – d’une manière générale, il détestait tous les professeurs, les donneurs de leçons, mais plus particulièrement ceux qui enseignent à Sciences-Po, à H.E.C. et dans les écoles de commerce, à Normale Sup et à l’E.N.A., il détestait les normaliens aussi bien que les sorbonnards Roland Barthes et Michel Foucault, il détestait les politiciens normaliens, ceux qui comme Giscard ou Bruno Le Maire écrivent de pitoyables romans érotiques), il détestait les féministes, les gouines et les pédés, les femmes prétendument libérées, il détestait les jeunes femmes socialement bien intégrées qui n’avaient même pas le charme de la Lolita de Nabokov, il détestait, outre les professeurs, les fonctionnaires payés à ne rien foutre, qui ne se réveillent que pour défendre des intérêts corporatistes, il détestait les jeunes, les cul-terreux du village dans lequel il avait habité, il détestait ses voisins, les acteurs et les actrices de cinéma, les metteurs en scène de théâtre, et tout ce qui se prétendait « artiste » ou « saltimbanque ». En un mot, il détestait ses contemporains. Il détestait ceux qui n’avaient pas lu Les Aphorismes sur la sagesse dans la vie de Schopenhauer, le De Brevitatis vitae (De la brièveté de la vie) de Sénèque, tous ceux qui ne partageaient pas son admiration pour Leopardi, pour le cinéma italien de la grande époque.
Paolo avait fait remarquer à Antoine à propos du choix de la brasserie qu’il avait eu raison : quitte à dépenser son argent, autant se faire plaisir. Antoine n’avait pas réagi sur le coup, mais non il n’avait pas forcément raison : il aurait par exemple mieux fait d’écrire une satire de son époque et de ses contemporains, à la manière du roman Les Choses (1965) de Georges Perec ou de l’essai de Jean Baudrillard, une dénonciation de la société de consommation, de l’aliénation par les objets, par les images, par le travail et par le divertissement. Il avait réalisé après coup que les serveurs n’ayant pas l’élégance des dandies à la manière d’Oscar Wilde ne lui inspiraient qu’une sympathie modérée, comme il avait toujours été dubitatif à l’égard des habiles et des malins. Il avait un contentieux toujours ouvert avec ceux qui avaient abusé de sa fragilité psychologique et de sa faiblesse physique.
Par ailleurs, Antoine se souvenait des chouettes romans américains de sa bibliothèque : Mort dans l’après-midi dans lequel Hemingway évoquait sa passion pour la tauromachie, les romans de Dos Passos et de Steinbeck qui faisaient revivre les années de la Grande Dépression aux Etats-Unis, ceux de Faulkner, dont Le Bruit et la Fureur, empruntant son titre à Shakespeare, évoquant la vie des dégénérés dans le sud des Etats-Unis (qui, curieusement, lui faisait toujours penser à ses voisins dans le petit village de Provence où il avait vécu), De sang-froid de Truman Capote, dans lequel il était question d’un fait-divers sordide, Cosmopolis de Don DeLillo, l’odyssée d’un golden boy au cours d’une après-midi de grève et de manifestations, dans sa voiture de luxe aux vitres teintées emplie de gadgets et d’écrans électroniques, pour aller se faire faire une coupe de cheveux à l’autre bout de la ville, ou Pastorale américaine, roman dans lequel Philip Roth déconstruisait le mythe de l’American Way of Life.
Ainsi que des films de Martin Scorsese, racontant des histoires de chute et de rédemption, comme dans Raging Bull (1980), ou de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique (1983), une histoire d’amitié entre deux petits malfrats dans le quartier juif de New York.
Autant d’histoires qui nous permettent d’échapper temporairement à ce que la réalité a de trop trivial. « Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité » (Nietzsche).
Les juifs, Antoine savait qu’il ne fallait pas trop y toucher. Il gardait un peu de sympathie pour les intellectuels cosmopolites d’avant-guerre, comme Stefan Zweig, auquel il préférait néanmoins Arthur Schnitzler, dont la Traumnovelle (1925) avait inspiré le Eyes Wide Shut (1999) de Kubrick. Il aimait donc surtout ceux qui faisaient des films : parmi les réalisateurs du 7e art du XXe siècle, Antoine gardait une préférence pour des génies tels que Billy Wilder, Stanley Kubrick et Woody Allen.
Antoine et Paolo étaient néanmoins d’accord pour admirer Céline. Paolo venait de découvrir Le Voyage au bout de la nuit, qu’Antoine avait lu avec ferveur quand il était adolescent. Ils en admiraient tous deux la structure : depuis la place Clichy, le départ pour le front de la Première Guerre mondiale, les aventures en Afrique après la traversée en bateau, la description des passagers vissés à leur verre d’apéritif, la fièvre dans la forêt équatoriale, puis la découverte de l’Amérique, New York, les usines Ford à Détroit, Céline prenant soin de se victimiser et de passer sous silence son admiration pour le fordisme, cette forme de travail la plus déshumanisante pour l’homme, comme l’a montré Charlie Chaplin dans Les Temps modernes, enfin le retour en banlieue parisienne pour exercer la profession de médecin au milieu de cette humanité crasseuse, animé par un désespoir qui n’était tempéré que par l’humour noir.
Mais il y avait aussi L’Eglise, sa pièce de théâtre, Mort à Crédit (1936), récit de ses aventures à Paris dans les années de sa jeunesse, ainsi que sa trilogie D’un château l’autre, Nord, Rigodon, racontant son périple à travers l’Allemagne et le Danemark en suivant Pétain après la libération de la France par les Alliés.
Il y avait surtout les pamphlets antisémites, Les Beaux Draps, L’Ecole des cadavres, dont le propos parfois insoutenable suscitait de la jubilation et d’indéniables plaisirs de lecture.
Ce qui amenait Antoine à se poser toujours la même question : comment avait-il fait ? D’abord, pour écrire tant de pages, ensuite pour affirmer ses convictions extrémistes avec autant de forces tout en se posant en victime ? Et comment se faisait-il qu’il était un siècle plus tard considéré comme un grand styliste de la langue française, salué par ceux-là même qui combattaient l’antisémitisme avec la dernière énergie ?
Il y avait certes les lois du commerce, bien plus incontestables que les principes éthiques, dans une société où si l’on se souciait apparemment que la justice fût forte et que la force fût juste, c’étaient surtout les lois du commerce qui avaient la force avec elles pour se faire respecter tandis que la dignité humaine était toujours aussi fragile.
Et il y avait le style, la force d’un style unique, inimitable, qui emporte tout sur son passage, y compris l’adhésion des esprits les plus critiques et des plus fervents détracteurs.
Ce style qu’Antoine n’avait pas et n’aurait sans doute jamais, cette puissance, cette capacité de persuasion qui surmonte tous les obstacles et permet de s’affirmer en fondant la confiance en soi sur la victimisation.
Le devoir d’Antoine était d’éviter la lucidité, éviter la lucidité à tout prix. Parce que la lucidité l’aurait amené à constater en premier lieu qu’en plus d’être un poids pour la société et pour ses proches, il n’avait que modérément réussi – peut-être parce que s’il avait beaucoup tenté, il l’avait fait maladroitement et avec des moyens limités – et qu’en guise de style, il avait surtout celui d’un gentil gaffeur dont les aptitudes principales étaient l’observation et la contemplation, considéré par beaucoup de gens comme insignifiant, ce qui aurait pu le conduire dans un second temps à des extrémités irréversibles.
En conclusion de cette réflexion à propos de l’effet de la pauvreté sur l’esprit, un des buts de la vie d’Antoine était d’éviter la lucidité pour ne pas trop penser au suicide, sauf à considérer que les plus beaux appartiennent à la littérature.
Il lui fallait à tout prix éviter de se comparer aux écrivains capables d’écrire des centaines ou des milliers de pages et de se faire éditer, lui qui était à peine capable d’écrire quelques pages avec la capacité de travail d’une huître lymphatique - et en compensation, il pouvait se dire qu’il était allé plus loin qu’un écrivain comme Bédé le Bègue dans le nihilisme romantique : lui au moins ne s’était pas reproduit -, tout comme il lui fallait éviter la confrontation avec les nantis qui trouvaient toujours le moyen de se plaindre de leurs problèmes de riches.
Il avait été un héros très discret tout au long de sa vie, il n’avait plus qu’à continuer. Pas grand-monde n’avait envie d’entendre ce qu’il avait à dire, et c’est un peu trop docilement qu’il avait accepté cet état de fait.
Dans la tiédeur de cette nuit de printemps, il se rendait compte qu’il lui restait quand même beaucoup et plus que ça, encore : jouir du fait d’être en vie, apprécier la douceur de cette nuit sans étoiles, admirer la beauté des marronniers en fleur qu’il avait croisés tandis qu’il pédalait sur son vélo déglingué tout au long du chemin du retour, et se laisser émouvoir par la fragilité de la beauté : un écureuil qui sautille au fond du jardin, un martin-pêcheur qui fait le guet sur un tronc au-dessus d’une rivière, un couple de papillons qui volette au-dessus des fleurs de courgettes du jardin, la majesté des gorges du Verdon, symbole de l’écosystème menacé par l’activité des hommes, ou la troublante luminosité d’une aurore boréale dans la nuit arctique au large du détroit de l’Orb en Sibérie septentrionale.
Il lui restait aussi les souvenirs, ceux de l’époque où il fréquentait le salon du Livre en se demandant s’il deviendrait jamais écrivain, les jardins publics à Paris, les musées qu’il avait fréquentés à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et dans les villes d’art italiennes.
Pour se changer les idées, après cette soirée bien arrosée à la brasserie Mollard, il avait décidé de se remettre au sport. Le lendemain, samedi après-midi, il était retourné à la piscine. Beaucoup de monde. Au milieu des gens, il avait bien du mal à avancer. Ses muscles lui paraissaient atrophiés. Longtemps, il avait cru qu’il n’y avait que les abdominaux qui lui faisaient défaut, mais en fait dans tout le corps il manquait de muscles toniques, durs et impeccablement dessinés. Dans les longueurs en brasse, il avait ces petites crises d’angoisse, et après les longueurs sur le dos, il avait des vertiges. Pendant les longueurs sur le dos, il se livrait à la méditation : il s’imaginait faire la sieste sur un beau lit à l’ancienne avec des draps aux motifs fleuris, tandis que la fenêtre était ouverte sur une belle journée d’été et l’arbre de la cour, comme chez sa tante, à Creissan. En bas, les femmes s’affairaient en cuisine, pour préparer un bon repas avec des produits du marché, frais et naturels : une bonne blanquette de veau à l’ancienne, un navarin d’agneau, une bourride provençale ou un aïoli du tonnerre de dieu. Les hommes discutaient des affaires d’adulte en buvant l’apéritif, politique, économie, augmentation du coût de la vie, menaces de guerre, ainsi que des voyages d’affaires qui les avaient conduits aux quatre coins de la planète. Mi-éveillé, mi-endormi, il se prenait pour Proust, en imaginant les poules de la basse-cour, les lapins de sa grand-mère dans leurs clapiers, des lapins gigantesques et appétissants destinés à finir en civet. Il se rappelait les Fables de La Fontaine, inspirées de Phèdre et d’Esope, et celles de Jean Anouilh, offrant une vision modernisée du pouvoir de ces satires subtiles des mœurs humaines et des comportements en société de ses contemporains, animés par des motifs qui n’étaient pas toujours élevés : cupidité, avidité, avarice, envie, jalousie, vaine gloriole prenaient souvent le pas sur la beauté du geste désintéressé. Et puis, il y avait un bruit de portière de voiture qui claque, un invité était arrivé. Mais qui cela pouvait-il bien être ? Dans un premier temps, il se disait que ça ne pouvait être une des chères voix qui se sont tues, ses grands-parents, ou son grand-oncle par exemple, tout au plus un ami de la famille, alors il s’en moquait un peu. Ensuite, mû par la curiosité et l’instinct de sociabilité, il se levait pour aller à la rencontre du nouveau venu, bien qu’il sût que celui-ci n’avait pas beaucoup de bonnes nouvelles à lui apporter.
Cette méditation l’occupait quand il y avait beaucoup de monde dans la piscine, ça avait été mieux par la suite avec l’éclaircie et l’apparition du soleil au-dessus de la verrière : après l’effort, le réconfort. Mais là, il avait de telles courbatures aux épaules et aux bras qu’il n’en pouvait plus. Il avait fait son kilomètre, il lui restait les plongeons et les assouplissements. Les pompes, ça avait été un calvaire, heureusement il avait pu faire un peu de crunch. Pour se consoler, il y avait les illusions : sur son plot, il s’imaginait qu’il était en pleine nature, sur un rocher prêt à plonger dans la fontaine d’eau pure d’une clairière au milieu des arbres.
En sortant de la piscine, il avait retrouvé l’air frais du dehors, et une sensation qu’il avait déjà éprouvée mille fois : une fraîcheur printanière, qui lui rappelait ses promenades dans la campagne provençale, un ciel bas et lourd de nuages hollandais qui lui faisait penser à Vermeer et à Rembrandt qui, avec leur palette, auraient su rendre les couleurs de cette heure particulière, à Descartes - Je pense donc je suis, c’est déjà un petit bonheur -, et au grand Van Gogh, qui faisait le lien entre des lieux qu’il affectionnait, la Provence autour d’Arles et de Saint-Rémy, la grande banlieue du côté d’Auvers, entre différentes époques de l’histoire de l’art, aussi bien qu’entre différentes époques de sa vie, de la jeunesse à l’âge mûr. Et puis, les nuages disparaissaient pour laisser apparaître un soleil de fin d’après-midi, qui lui rappelait ses promenades dans Milan - et un film comme La Notte d’Antonioni, avec Marcello Mastroianni et Jeanne Moreau qui se promènent dans les rues en observant leurs ombres après être allé rendre visite à un ami malade -, dans les villages du Piémont - Ah, Fossano et Saluzzo ! et les Langhe, la colline de Grinzane Cavour au sommet de laquelle se trouve la maison des vins, entourée de coteaux et de vignes à perte de vue, où passaient des tracteurs conduits par des paysans qui ne craignaient pas la pente du terrain, ou dans les collines toscanes d’où, entre deux cyprès et une église, on pouvait apercevoir les crete senese, imaginer les chefs-d’œuvre architecturaux de Sienne, le palio de Sienne, rêver aux Médicis de Florence, au Prato de Malaparte désormais envahi par des zones industrielles et commerciales où des Chinois fabriquaient des produits bas de gamme ; cet intellectuel de Tabucchi pouvait bien traiter Malaparte et d’Annunzio de salauds, les vrais salauds, c’étaient les responsables de l’industrialisation, qui avec le prétexte du progrès technique, salissaient les beaux paysages naturels de l’Italie éternelle pour faire du profit, toujours plus de profit ; quant aux ouvriers immigrés qui travaillaient pour eux, soit ils étaient mieux ici qu’au pays natal et n’étaient donc pas très à plaindre, soit ils étaient habités par une nostalgie indéfinissable, sauf que de temps en temps survenait un accident qui attirait sur eux l’attention des media et une vague compassion de la part de l’opinion publique, permettant ainsi aux petites-bourgeoises de se donner une contenance en même temps qu’une conscience sociale.
Il ne pensait pas que le fait de parler et d’ouvrir la bouche pût changer grand-chose à sa vie : c’étaient toujours les mêmes crétins qui bossaient comme des fourmis, les mêmes technocrates gris et compassés qui gouvernaient le monde en faisant la gueule en public, des affaires louches et la fiesta aux frais du contribuable en privé ; c’étaient toujours les mêmes monstres, sombres guignols bariolés sur la scène soi-disant artistique et culturelle de son pays ; c’étaient toujours les mêmes précieuses ridicules qui trouvaient un motif de récriminer contre les hommes pour mieux s’attirer compensations financières et statuts d’exception. Il ne pouvait pas dire que toutes les femmes étaient les mêmes mais elles se ressemblaient toutes, avec des variations si infimes que ça ne valait pas la peine d’y prêter une attention excessive. Ouvrir la bouche et parler ne permettait pas de changer grand-chose : il en voulait pour preuve qu’au retour de la piscine, il avait croisé son voisin bronzé, frais et dispos quand lui était si fatigué ; lui aussi revenait de la piscine, mais celle du Lutetia où il avait pu nager pratiquement seul et sans même payer l’abonnement hors de prix. Comme il l’avait dit : « l’abonnement, il faut pouvoir le sortir », il ne l’avait pas sorti, c’était un de ses clients qui le lui avait offert. Antoine en déduisait que les gens ont un métier pour s’attirer des privilèges et des passe-droits. Quant à Antoine, que ses relations considéraient comme un privilégié, non seulement il avait sa conscience pour lui, mais la modicité de ses moyens et l’absence de relations l’obligeait à fréquenter la piscine municipale envahie de monde. Et il avait intérêt à avoir la monnaie :
— Je n’ai pas de monnaie, lui sortait l’employé sur un ton rogue et avec une mauvaise volonté évidente, tout fier de son accent petit nègre.
— Mais vous travaillez au service du public au vous êtes payés à en faire le moins possible, assis sur vos principes ?
— Je ne suis pas payé à rien fout’, dis-donc ! Je suis un fonctionnaire au service de l’Etat français, celui-là même qui a aboli l’esclavage il y a deux siècles. Tu ferais bien de mieux connaît’ l’histoire de ton pays, petit blanc.
Antoine était ravi d’apprendre qu’il n’y avait plus d’esclavage pour les nègres de France. Il savait cependant qu’il y avait toujours des camps de concentration pour les Ouïgours qui travaillaient pour le compte des multinationales occidentales. Et que les nègres aimaient s’acheter des vêtements sportifs de marque, fabriqués par des esclaves du tiers-monde, la consommation ostentatoire, dénoncée par Thorstein Veblen dans sa Théorie de la classe de loisir au siècle dix-neuvième, n’étant plus réservée aux superriches depuis belle lurette. Il les avait un peu lus, les sociologues, Marx ennemi de Pareto, Max Weber, Gurvitch, Durkheim, Marcel Mauss, Le Nouvel Etat industriel de J. K. Galbraith, dans lequel celui-ci rappelait que la technostructure n’a d’autre ambition que de justifier sa raison d’être, Raymond Aron et Raymond Boudon. Il aurait pu faire de la sociologie lui aussi, pour dénoncer la société de consommation, comme Georges Perec dans son roman Les Choses (1965). Mais ça ne s’était pas passé comme ça. Il se souvenait du Potlatch, il avait un peu de mal avec l’idéologie du don, naturalisé par l’école, qui permet aux cuistres de considérer leurs privilèges comme légitimes, même s’il savait que ce n’est pas ce dont parlait Marcel Mauss dans son Essai sur le don. Et il considérait qu’un grand sociologue est un sociologue mort, comme Bourdieu par exemple.
Qu’il avait douce souvenance des cours de sociologie politique de sa jeunesse ! C’est la science politique qui permet d’établir une critique rationnelle des discours extrémistes comme des éléments de langage des membres du gouvernement, pour lesquels l’intérêt général est un masque, une invocation totémique, à l’ombre desquels ils gèrent leurs petites carrières et leurs privilèges indus.
Juin 2023.